02 Juil Étude transfrontalière du complotisme mondial : croyances, dynamiques et réponses gouvernementales
Conspirations emblématiques selon les régions
Occident (Europe et Amérique du Nord)
Dans les pays occidentaux, plusieurs théories du complot marquantes se sont répandues ces dernières années. Aux États-Unis, QAnon est devenu emblématique : il postule qu’une élite pédophile sataniste contrôlerait le gouvernement, et qu’un mystérieux agent « Q » aide Donald Trump à la combattre lemonde.fr. En Europe, on retrouve par exemple la théorie du « Grand Remplacement », une croyance d’extrême droite selon laquelle les élites orchestrent le remplacement des populations « de souche » par des immigrants musulmans ou africains ipsos.com. D’autres conspirations occidentales notables incluent les thèses conspirationnistes sur le 11-Septembre 2001 (prétendant que les attentats auraient été planifiés en interne) et la mouvance anti-vaccins (affirmant que les vaccins COVID-19 contiendraient des puces ou seraient plus dangereux qu’annoncé). La pandémie a effectivement nourri des rumeurs de virus créé en laboratoire et de projets secrets de vaccination forcée, jusqu’à un mouvement international comme « Plandémie » qui a trouvé un écho dans ces pays.
Niveau d’adhésion : La prévalence du complotisme en Occident varie, mais demeure significative. Aux États-Unis, plus de la moitié des citoyens adhèrent à au moins une théorie du complot up-magazine.info. Par exemple, environ 25 % des Américains adhèrent désormais au noyau des thèses de QAnon (croyance en une élite pédosataniste, etc.), en hausse par rapport à 15 % en 2021 lemonde.fr. De même, près de 59 % des électeurs républicains estiment que l’élection présidentielle de 2020 a été truquée ipsos.com, reflétant la diffusion de la thèse du « vol de l’élection ». En Europe de l’Ouest, l’adhésion est un peu moindre mais non négligeable : environ un Français sur trois (35 %) déclare croire à des théories complotistes, contre 55 % des Américains up-magazine.info. Certaines idées conspirationnistes trouvent un large écho, comme la croyance au Grand Remplacement (env. 25 % en moyenne dans dix grands pays) ou au canular lunaire (jusqu’à 18 % pensent que les images des missions Apollo ont été tournées en studio) ipsos.com ipsos.com. Les pays européens affichent aussi une minorité sensible aux théories farfelues – par ex. 11 % des Français jugent possible que la Terre soit plate up-magazine.info – mais globalement moins qu’en Amérique du Nord.
Réactions des gouvernements : Les pouvoirs publics occidentaux oscillent entre efforts d’information et régulation. Plusieurs gouvernements ont lancé des campagnes d’information pour contrer la désinformation, surtout pendant la crise du COVID-19 (sites officiels de fact-checking, messages de sensibilisation à la vaccination, etc.). L’Organisation mondiale de la santé a parlé « d’infodémie » et travaillé avec les États sur la diffusion de sources fiables. Des pays comme la France ont intégré l’éducation aux médias dans les programmes scolaires (via le CLEMI notamment) afin de développer l’esprit critique face aux fake news. Parallèlement, des mesures de régulation d’Internet ont émergé : l’UE a mis en place un Code de bonnes pratiques contre la désinformation et des unités telles que EUvsDisinfo pour repérer les infox, tandis que l’Allemagne ou la France ont voté des lois contre les fausses informations en période électorale. On observe aussi une pression sur les réseaux sociaux pour censurer les contenus complotistes les plus nocifs (ex : suppression des groupes QAnon sur Facebook en 2020). Toutefois, la censure directe est rare en démocratie – le débat oppose liberté d’expression et lutte contre la haine/conspirationnisme. Aux États-Unis, les autorités misent davantage sur le démenti public et la transparence (ex : le FBI et les tribunaux ont réfuté les allégations de fraude électorale de 2020, et le gouvernement Biden a multiplié les conférences de presse pour contrer les mythes sur les vaccins). Néanmoins, certains responsables politiques ont eux-mêmes alimenté des théories : l’administration Trump a relayé des contre-vérités sur le COVID-19 ou les fraudes électorales, brouillant la réponse institutionnelle. Globalement, la tendance occidentale est d’informer et d’éduquer davantage que de censurer, tout en développant des stratégies de communication de crise. Par exemple, le gouvernement britannique a créé une unité de « rapid rebuttal » pour répondre rapidement aux rumeurs en ligne, et la Maison-Blanche a collaboré avec des influenceurs sur TikTok pour diffuser des messages factuels sur le coronavirus.
Impacts sur la société : Le complotisme occidental a des répercussions tangibles. Sur le plan de la cohésion sociale, il alimente la polarisation et la méfiance envers les institutions. Aux États-Unis, la diffusion de QAnon et des théories sur une prétendue « élite globale » renforce la fracture entre partisans et opposants, et radicalise une frange de la population (16 % des Américains adhérant à QAnon se disent prêts à recourir à la violence pour « sauver » le pays) prri.org prri.org. En Europe, des mouvements anti-système comme les « gilets jaunes » en France ont été pénétrés par des narratifs complotistes (ex : sur les vaccins ou sur des « complots » élitistes), ce qui a pu durcir leur défiance envers le gouvernement. Sur le plan de la santé publique, les théories complotistes ont freiné les campagnes sanitaires. La crainte infondée que les vaccins COVID contiennent des micropuces ou provoquent la stérilité a contribué à la réticence vaccinale dans divers pays occidentaux, compliquant la lutte contre la pandémie. Ainsi, jusqu’à un quart de la population dans certains pays occidentaux pensait que la pandémie faisait partie d’un plan pour imposer la vaccination mondiale isdglobal.org ipsos.com, ce qui a réduit l’adhésion aux mesures de santé (masques, confinement, vaccins) et conduit à des résurgences épidémiques. Enfin, l’impact politique est majeur : des élections et référendums ont été influencés par des infox et complots. Le cas le plus frappant est l’assaut du Capitole à Washington le 6 janvier 2021, lorsque des milliers de personnes, convaincues par la théorie d’un complot de fraude électorale massive, ont tenté d’empêcher la certification des résultats lemonde.fr. De même, en Europe, la théorie du « Grand Remplacement » a nourri la rhétorique de partis d’extrême droite et parfois des actes violents (le terroriste de Christchurch en 2019 ou le tireur de Buffalo en 2022 se réclamaient de cette théorie unesco.org unesco.org). On voit donc que dans les démocraties occidentales, le complotisme érode la confiance civique, radicalise certains individus et peut menacer directement le processus démocratique et l’ordre public.
Asie (Chine, Inde, Asie du Sud/Sud-Est)
Le paysage conspirationniste en Asie est très divers, chaque sous-région ayant ses mythes dominants. En Chine, les théories du complot se mêlent souvent à la propagande nationaliste. Un exemple marquant est la théorie selon laquelle le virus du COVID-19 aurait été créé par l’armée américaine à Fort Detrick et introduit en Chine securingdemocracy.gmfus.org. Des officiels et médias d’État chinois ont largement diffusé cette idée dès 2020 pour détourner l’attention de Wuhan, inondant Internet d’articles et de tweets à ce sujet securingdemocracy.gmfus.org. La désinformation sanitaire existe aussi dans l’autre sens : des rumeurs locales en Chine ont prétendu que le gouvernement cachait le véritable bilan du virus ou utilisait l’application de traçage pour surveiller politiquement les citoyens, ce qui a accru l’anxiété de la population. En Inde, on retrouve de nombreuses théories à connotation religieuse ou politique. Les milieux nationalistes hindous ont popularisé la notion de « Love Jihad », un complot imaginaire accusant les hommes musulmans de séduire des femmes hindoues afin de les convertir à l’islam et changer la démographie du pays thediplomat.com. Plusieurs États indiens dominés par le BJP sont même allés jusqu’à voter des lois anti-« Love Jihad » thediplomat.com. D’autres fantasmes, comme le « Population Jihad », prétendent que la forte natalité des musulmans fait partie d’un plan secret pour supplanter les hindous thediplomat.com. Par ailleurs, le sous-continent a de longue date une théorie du complot tenace autour du vaccin antipolio : au Pakistan et dans le nord de l’Inde, des prédicateurs extrémistes diffusent l’idée que la vaccination anti-polio serait un stratagème occidental pour stériliser les enfants musulmans thediplomat.com. Cette croyance, renforcée après l’affaire de la fausse campagne de vaccination utilisée pour localiser Ben Laden en 2011, a conduit à des refus de vacciner et même à des assassinats d’agents de santé. En Asie du Sud-Est, on observe également des théories conspirationnistes locales. En Myanmar, la junte a justifié le coup d’État de 2021 en invoquant des fraudes électorales imaginaires et une « menace terroriste » orchestrée par des puissances étrangères, alimentant un narratif complotiste pour légitimer sa répression. En Indonésie ou en Malaisie, des rumeurs circulent sur un prétendu agenda caché des minorités religieuses (par exemple, des extrémistes islamistes ont accusé des communautés chrétiennes de comploter contre l’islam, et vice-versa), entretenant la méfiance intercommunautaire. Enfin, même des pays développés d’Asie de l’Est ne sont pas épargnés : au Japon, on a vu émerger une petite communauté de partisans de QAnon, et en Corée du Sud des groupes ont propagé des rumeurs farfelues (comme l’idée que la 5G propage le coronavirus, importée du discours complotiste occidental).
Niveau d’adhésion : La proportion de personnes croyant aux complots en Asie varie énormément selon les pays et le niveau d’éducation. En Chine, il est difficile de mesurer l’adhésion réelle (faute de sondages indépendants), mais les théories promues par l’État – comme le complot étranger sur l’origine du COVID – ont trouvé un large écho grâce au contrôle des médias. Des millions de Chinois ont signé en 2021 une pétition en ligne exigeant une enquête sur le laboratoire de Fort Detrick aux États-Unis, signe d’une adhésion populaire au récit d’un virus importé securingdemocracy.gmfus.org. En Inde, les enquêtes d’opinion révèlent qu’une part non négligeable de la population croit à des idées pseudoscientifiques ou complotistes : par exemple, un sondage national en 2020 montrait qu’environ 23 % des Indiens pensaient que le coronavirus était délibérément propagé par un groupe spécifique (ciblant souvent les musulmans, dans ce qu’on a appelé la théorie du « Corona Jihad ») – cette rumeur a prospéré après qu’un foyer épidémique eut été lié à un rassemblement missionnaire musulman (Tablighi Jamaat) thediplomat.com thediplomat.com. Au Pakistan et en Afghanistan voisins, la méfiance envers les vaccins est élevée : jusqu’à 40-50 % des familles dans certaines zones rurales du Pakistan refusaient le vaccin antipolio au plus fort des rumeurs de stérilisation thediplomat.com. Cette défiance a fait que la polio, éradiquée ailleurs, subsiste dans ces régions. En Asie du Sud-Est, l’adhésion est plus difficile à quantifier ; toutefois, des fake news conspirationnistes se sont largement répandues via WhatsApp et Facebook, très utilisés dans la région. Aux Philippines, une étude de 2021 a révélé qu’un nombre important de citoyens (jusqu’à 20 %) croyait aux allégations complotistes en ligne de l’entourage de l’ex-président Duterte – par exemple l’idée que les critiques de la « guerre contre la drogue » faisaient partie d’un complot international pour nuire au pays. Globalement, les théories du complot ont pignon sur rue dans de nombreuses sociétés asiatiques, souvent amplifiées par les réseaux sociaux et la faible confiance envers les autorités officielles.
Réponses gouvernementales : Les réactions des gouvernements asiatiques varient entre censure, propagande concurrente et éducation. Dans les régimes autoritaires (Chine, Myanmar, Vietnam, etc.), la réponse privilégiée est la censure et le contrôle d’Internet. La Chine, par exemple, censure rapidement les théories du complot non validées par l’État (celles qui critiquent le régime) tout en alimentant ses propres récits conspirationnistes utiles. Pékin a mené de véritables campagnes de désinformation officielles – par exemple en envoyant plus de 1 000 messages sur Twitter et articles de presse d’État pour accréditer la thèse d’un complot américain autour du COVID securingdemocracy.gmfus.org securingdemocracy.gmfus.org. En contrepartie, toute mention du « document de Wuhan » ou des questions gênantes sur la gestion initiale de l’épidémie a été strictement filtrée en ligne. On retrouve ce schéma en Iran également (souvent inclus dans le Moyen-Orient, mais culturellement lié à l’Asie) : Téhéran bloque ou emprisonne les auteurs de rumeurs anti-régime, tout en promouvant sa propre ligne (par exemple en 2020, le Guide suprême a interdit l’importation de vaccins occidentaux en les qualifiant de complot pour infecter la nation, et a diffusé des théories liant l’épidémie à une « attaque sioniste » – une position officielle qui a encouragé ces croyances). Dans les démocraties asiatiques, les gouvernements combinent démentis publics et initiatives pédagogiques. L’Inde a mis en place une cellule de fact-checking au sein du ministère de l’Information (PIB Fact Check) pour réfuter les fake news virales, et a coopéré avec des chefs religieux locaux pour dissiper des mythes (par ex., en 2021, des imams respectés ont été sollicités pour encourager la vaccination anti-COVID auprès des communautés musulmanes). Au Pakistan, face aux complots antivaccins, les autorités ont déployé des stratégies innovantes : campagnes locales d’information dans les mosquées, recrutement de personnalités islamiques influentes pour affirmer publiquement que les vaccins sont halal et sûrs thediplomat.com thediplomat.com. Le gouvernement pakistanais a aussi eu recours à la fermeté : des arrestations ponctuelles de diffuseurs de fausses nouvelles sur le vaccin polio ont eu lieu, et des escortes armées protègent les équipes médicales dans les zones à risque reuters.com reuters.com. Dans plusieurs pays d’Asie du Sud-Est (Malaisie, Singapour), des lois anti-“fake news” ont été votées, permettant de punir d’amende ou de prison les auteurs de fausses rumeurs – bien que ces lois aient parfois été critiquées pour avoir servi à réduire au silence des opposants plus qu’à combattre réellement le complotisme. Enfin, certaines réponses relèvent de la communication de crise innovante : Taïwan, par exemple, a efficacement contré des rumeurs (comme l’idée d’une pénurie de papier toilette due aux masques) en diffusant de l’information corrective sous forme humoristique et virale, démontrant qu’une approche transparente et créative peut endiguer la peur complotiste.
Impacts sur la société : En Asie, le complotisme influence fortement la cohésion sociale, la santé publique et la politique. Sur le plan social, certaines théories alimentent des conflits intercommunautaires. En Inde, les mythes de « Love Jihad » ou « Population Jihad » ont contribué à attiser la méfiance et la haine entre hindous et musulmans, justifiant aux yeux de certains les violences sectaires ou les lois discriminatoires thediplomat.com thediplomat.com. Au Myanmar, les fausses rumeurs accusant la minorité Rohingya de comploter pour islamiser le pays ont précédé et accompagné les campagnes de nettoyage ethnique de 2017, montrant le rôle du complotisme dans les tensions ethniques. En ce qui concerne la santé publique, l’Asie a payé un lourd tribut aux rumeurs complotistes. La défiance envers le vaccin polio au Pakistan et en Afghanistan a provoqué des retards dans l’éradication de la maladie : des familles ont refusé l’immunisation de leurs enfants, entraînant de nouvelles épidémies locales dans les années 2010 reuters.com. Des agents de santé vaccinant contre la polio ont même été assassinés sous l’emprise de ces théories (neuf vaccinateurs tués à Kano, Nigeria, en 2013, par des extrémistes persuadés du complot – un cas similaire influençant les équipes au Pakistan voisin) reuters.com reuters.com. Durant la pandémie de COVID-19, des rumeurs en Inde (par ex. que boire des tisanes ou de la gau mutra – urine de vache – protège du virus) ont pu détourner certains citoyens des recommandations scientifiques, tandis qu’en Asie centrale des personnes se sont empoisonnées en suivant de faux « remèdes » miracles circulant en ligne. Enfin, l’impact politique du complotisme en Asie est visible tant au niveau des mouvements extrémistes que des décisions géostratégiques. Des gouvernements autoritaires ont survécu à des mouvements de protestation en réorientant le récit vers des conspirations étrangères, ce qui leur permet de justifier la répression (par exemple, en Iran ou en Chine, qualifier les manifestants d’« agents de complots occidentaux » sert à légitimer leur emprisonnement). Par ailleurs, les théories du complot sont devenues un vecteur du violent extrémisme : en Asie du Sud, elles alimentent aussi bien le jihadisme (vision d’un complot occidental contre l’islam nécessitant le jihad) que l’extrémisme hindou (vision d’un complot islamique contre l’Hindouité) thediplomat.com thediplomat.com. Le résultat concret est une montée des violences : attentats contre des centres de vaccination, lynchages de couples mixtes, émeutes anti-minorités, etc. Ainsi, les conspirations agissent comme un catalyseur d’extrémisme en fournissant une grille manichéenne (« nous contre eux ») justifiant la violence thediplomat.com thediplomat.com. On constate donc qu’en Asie, le complotisme sape la confiance entre communautés, freine des progrès sanitaires cruciaux et parfois sert directement d’outil de pouvoir ou de propagande interne.
Afrique (Afrique du Nord et Afrique subsaharienne)
L’Afrique est également traversée par des théories du complot, souvent teintées par l’histoire coloniale et les réalités socio-économiques du continent. En Afrique du Nord, beaucoup de conspirations rejoignent celles du Moyen-Orient arabo-musulman (antisémitisme, soupçons envers l’Occident). Par exemple, au Maroc, en Algérie ou en Égypte, la croyance dans un vaste complot occidental (ou sioniste) pour affaiblir les nations musulmanes est répandue. Durant le « Printemps arabe », des dirigeants tels que Mouammar Kadhafi ou Bachar al-Assad (en Syrie voisine) ont clamé que les soulèvements populaires étaient orchestrés par l’étranger – CIA, Israël ou Qatar – plutôt que le fruit de revendications internes, et nombre de citoyens ont adhéré à ces récits. En Afrique subsaharienne, les théories du complot prennent diverses formes. L’une des plus persistantes est la thèse que les grandes puissances auraient intentionnellement propagé des maladies pour décimer la population africaine. Ainsi, la théorie du complot sur le sida – affirmant que le VIH aurait été créé en laboratoire par la CIA ou d’autres pour infecter les Africains – a circulé dès les années 1990 et 2000 fr.wikipedia.org. Elle a été aggravée par les propos de l’ex-président sud-africain Thabo Mbeki, qui soutenait des thèses niant le lien entre VIH et sida, semant la confusion. D’autres rumeurs médicales ont cours, comme l’idée que les campagnes de vaccination en Afrique cacheraient des visées malveillantes (stérilisation de masse, expérimentation secrète). Par exemple, au Nigeria, une théorie ancrée dans le nord du pays prétendait que le vaccin oral contre la polio faisait partie d’un complot occidental pour rendre les enfants musulmans stériles ou leur transmettre le VIH reuters.com. Cette croyance a mené en 2003-2004 à un boycott vaccinal dans plusieurs États du nord, provoquant une recrudescence de la polio qui a ensuite franchi les frontières vers d’autres pays africains reuters.com reuters.com. On trouve aussi des conspirations à caractère plus politique et culturel. En RDC et dans la région des Grands Lacs, certaines milices ont propagé l’idée que l’ONU ou les ONG étrangères orchestrent les conflits pour piller les ressources, alimentant la méfiance envers les casques bleus. En Afrique francophone de l’Ouest, la théorie du « néocolonialisme français » – si certaines de ses composantes relèvent de l’analyse politique légitime – est parfois extrapolée en une vision complotiste où chaque événement (chute d’un dirigeant, lancement d’un projet minier, attaque terroriste) serait entièrement téléguidé par Paris ou Washington dans l’ombre. Enfin, des croyances plus traditionnelles, comme la sorcellerie, se mêlent parfois au complotisme moderne : par exemple en Afrique du Sud, une panique sur les « enlèvements d’enfants pour sacrifices rituels commandités par des hommes d’affaires fortunés » a conduit à des émeutes contre des étrangers en 2019, démontrant le mélange de peur complotiste et de xénophobie locale.
Niveau d’adhésion : L’adhésion aux théories du complot en Afrique varie selon l’instruction et le contexte rural/urbain, mais certaines croyances sont étonnamment répandues. Par exemple, un sondage Afrobarometer de 2019 indiquait que plus de 50 % des Sud-Africains interrogés pensaient qu’il existait un « agenda secret étranger » derrière certaines politiques nationales (sans préciser lequel, signe d’un sentiment diffus de complot) – résultat en partie hérité de décennies d’apartheid et de guerre froide où de vrais complots ont existé. En Afrique de l’Ouest, diverses enquêtes informelles montrent qu’une majorité relative de personnes croit possible que le VIH ait été créé délibérément (un mythe popularisé aussi par certains chefs religieux). En Égypte, comme mentionné précédemment, jusqu’à 75 % de la population ne croit pas que les attentats du 11 septembre aient été commis par Al-Qaïda, beaucoup accusant plutôt une machination américano-israélienne washingtoninstitute.org. Cette tendance se retrouve dans d’autres pays nord-africains ou du Moyen-Orient. Concernant la pandémie de COVID-19, une étude de l’ONG Africa Check a mis en évidence qu’une part significative d’Africains (entre 20 et 30 % selon les pays) pensaient que le virus « n’existait pas vraiment » ou que les chiffres étaient grossis dans un but inavoué – ce qui a entraîné un relâchement des gestes barrières. Il faut aussi noter que le faible accès à l’information fiable dans certaines zones rurales permet aux rumeurs locales de prospérer : ainsi au Mali ou en Guinée, lors d’épidémies d’Ebola, de nombreux habitants croyaient plus aux explications mystiques ou complotistes (le « virus n’existe pas, c’est un poison apporté par les Blancs ») qu’aux messages officiels, rendant l’intervention sanitaire extrêmement difficile.
Réponses gouvernementales : Les gouvernements africains ont adopté diverses stratégies face au complotisme, oscillant entre la répression de la désinformation et des approches de sensibilisation communautaire. Dans plusieurs pays, l’arsenal législatif s’est étoffé : des lois pénalisant la diffusion de « fausses nouvelles » ont été promulguées, parfois sous prétexte de combattre les théories du complot. Par exemple, pendant la pandémie, le Kenya et le Sénégal ont averti qu’ils sanctionneraient sévèrement toute diffusion de rumeurs alarmistes sur le coronavirus. Ces mesures, cependant, suscitent la controverse – notamment lorsque des régimes autoritaires les utilisent pour museler des journalistes ou des opposants sous couvert de lutte contre la désinformation. Sur un plan plus positif, plusieurs États collaborent avec des autorités religieuses et locales pour contrer les rumeurs. Le Nigeria et le Pakistan (ce dernier non africain mais confronté à la même problématique) ont travaillé étroitement avec des imams et chefs traditionnels pour dissiper les fausses rumeurs autour du vaccin polio reuters.com. Ainsi, au Nigeria, le ministère de la Santé a impliqué dès 2016 des figures religieuses respectées pour promouvoir la vaccination, en échange de quoi ces leaders pouvaient vérifier les vaccins et rassurer leur communauté reuters.com. Des campagnes d’information en langues locales par radio communautaire ou théâtre de rue ont aussi été menées pour expliquer les enjeux sanitaires et désamorcer les idées de complot (par exemple en RDC pendant Ebola 2018-2020). En Afrique du Nord, où les régimes sont souvent méfiants envers toute narration alternative, la tendance a été de recourir à la censure pure et simple : l’Égypte a ainsi arrêté des blogueurs accusés de « répandre de fausses nouvelles » après qu’ils aient remis en question les chiffres officiels du COVID-19. De plus, ironiquement, certains gouvernements entretiennent eux-mêmes des discours complotistes pour servir leurs intérêts (blâmer des puissances étrangères pour des difficultés internes, par exemple). Enfin, côté initiatives éducatives, on voit émerger, soutenus par l’UNESCO ou l’ONU, des programmes d’éducation aux médias dans quelques pays (Côte d’Ivoire, Tunisie, etc.), visant à apprendre aux jeunes à discerner rumeurs et infos vérifiées. Toutefois, ces programmes restent embryonnaires comparés à l’ampleur du phénomène.
Impacts sur la société : Le complotisme en Afrique a des conséquences profondes sur la cohésion nationale, la santé et la gouvernance. Du point de vue de la cohésion sociale, certaines théories attisent la xénophobie ou le rejet de groupes. En Afrique du Sud, par exemple, la croyance que des immigrés forment un complot pour voler le travail des locaux a contribué à des vagues de violences xénophobes (émeutes de 2008, 2015, 2019). Dans le Sahel, des rumeurs accusant les casques bleus ou ONG d’être de mèche avec les groupes terroristes minent la confiance entre populations et forces internationales, compliquant les missions de paix. Sur le plan sanitaire, l’effet du complotisme a été dramatique : la lutte contre le sida en a souffert lorsque l’Afrique du Sud de Mbeki refusa pendant des années de généraliser les antirétroviraux en s’appuyant sur des thèses complotistes, ce qui a été estimé avoir coûté plus de 300 000 vies dans les années 2000 (par absence de traitement efficace). De même, lors de l’épidémie d’Ebola en Afrique de l’Ouest (2014-2016), la propagation de complots (comme « les médecins apportent la maladie pour tuer les Africains et voler leurs organes ») a provoqué la résistance de villages entiers aux équipes médicales. Un cas extrême fut le meurtre de huit membres d’une délégation sanitaire en Guinée en 2014, massacrés par des habitants persuadés qu’ils faisaient partie d’un complot maléfique. Ces exemples montrent comment la désinformation peut saboter les efforts de santé publique et transformer la peur en violence. Enfin, politiquement, le complotisme sape la gouvernance démocratique. Dans de nombreux pays africains, il nourrit un climat de suspicion généralisée où chaque action du gouvernement est vue comme potentiellement conspirative. Si une élection est perdue par un camp, on crie souvent au complot plutôt qu’à l’acceptation du verdict des urnes – ce qui délégitime les processus électoraux. Paradoxalement, les dirigeants autoritaires exploitent aussi ce terreau : ils justifient le maintien de l’ordre autoritaire en prétendant faire face à des « complots impérialistes », créant une union sacrée factice autour d’eux trtworld.com trtworld.com. Cette rhétorique a par exemple été employée par le président soudanais Omar el-Béchir, qui face aux manifestations de 2019 dénonçait un « complot étranger » pour expliquer la contestation radiotamazuj.org. Au final, en Afrique, le complotisme peut diviser les communautés, affaiblir la confiance envers les acteurs extérieurs bienveillants, et consolider des pouvoirs en place au détriment des aspirations démocratiques et du développement.
Moyen-Orient
Le Moyen-Orient est souvent considéré comme un terrain fertile au complotisme, en partie à cause d’une histoire jalonnée d’ingérences étrangères réelles et d’une atmosphère politique autoritaire propice aux récits simplistes. Des théories du complot emblématiques y circulent largement. L’une des plus répandues concerne le 11 septembre 2001 : une grande majorité d’opinions dans les pays arabes refuse la version officielle et attribue les attentats à un complot orchestré par les États-Unis ou Israël. En 2011, un sondage du Pew Research Center montrait que dans des pays comme l’Égypte, la Jordanie ou la Turquie, moins de 30 % des personnes pensaient qu’Al-Qaïda était responsable des attaques, et en Égypte 75 % affirmaient que ce n’étaient pas des Arabes qui avaient fait le coup washingtoninstitute.org. De même, la montée de Daech (ISIS) a été l’objet de nombreuses théories dans la région : beaucoup croient que l’État islamique a été créé de toutes pièces par la CIA, le Mossad ou le régime d’Assad pour discréditer les musulmans ou pour justifier une intervention occidentale. Cette idée que « le terrorisme islamiste est un complot contre l’islam » est encore très ancrée, relayée par exemple par des figures politiques irakiennes ou iraniennes. D’autres théories classiques du Moyen-Orient incluent le fameux « complot sioniste mondial » (héritier des Protocoles des Sages de Sion, texte antisémite malheureusement lu dans la région) : ainsi, chaque trouble majeur – de la guerre en Syrie à la division interpalestinienne – est parfois expliqué par l’action occulte d’Israël ou du « lobby juif ». On note aussi des croyances complotistes liées aux conflits locaux : par exemple, certains partisans de Bachar al-Assad en Syrie et de Muqtada al-Sadr en Irak affirment que les manifestations qui les ont visés étaient planifiées par l’Occident ou les pays du Golfe pour affaiblir l’« axe de la résistance ». Enfin, la pandémie de COVID-19 a donné lieu à des théories régionales spécifiques : en Iran notamment, des ayatollahs ultraconservateurs ont initialement suggéré que le coronavirus était une arme biologique américaine contre l’Iran, tandis qu’en Arabie saoudite des rumeurs extrémistes accusaient des chiites (de Qom en Iran) d’avoir volontairement propagé le virus chez les sunnites – deux récits conspirationnistes opposés alimentés par les tensions géopolitiques.
Niveau d’adhésion : Le degré d’adhésion du public aux théories du complot au Moyen-Orient est élevé comparé à d’autres régions. Divers sondages l’attestent : outre le cas du 11-Septembre déjà cité, un sondage de 2016 en Jordanie trouvait que plus de 60 % de la population croyait qu’Israël soutenait secrètement Daech pour déstabiliser les pays arabes. Au Palestine (Cisjordanie/Gaza), les enquêtes du Palestinian Center for Policy indiquent régulièrement qu’une majorité de Palestiniens pense que l’Autorité palestinienne collabore en secret avec Israël contre les intérêts du peuple – perception complotiste nourrie par les divisions internes. En Iran, le pouvoir en place entretient une vision conspirative du monde qui semble partagée par beaucoup : ainsi, selon une étude de 2020, environ 55 % des Iraniens estimaient que les sanctions économiques américaines faisaient partie d’un plan plus large pour fomenter une révolution chez eux (au-delà de la simple pression économique). Au Liban, pays fragmenté, chaque camp politique propage ses propres théories (par ex., certains chrétiens libanais croient à la théorie d’« Eurabia » – le complot d’islamisation de l’Europe – appliquée au Liban par les réfugiés syriens, tandis que des chiites pro-Hezbollah voient la main de la CIA derrière les protestations antigouvernementales de 2019). Globalement, la prévalence du complotisme est telle que dans de nombreux pays du Moyen-Orient, il constitue presque un paradigme explicatif banal : les malheurs nationaux sont spontanément attribués à des « mains invisibles » plutôt qu’à des dynamiques internes. Ce réflexe est si courant que même des responsables de gouvernement y adhèrent publiquement, renforçant encore son acceptation par la population.
Réponses gouvernementales : Les gouvernements du Moyen-Orient répondent au complotisme de manière paradoxale. D’un côté, plusieurs régimes encouragent ou exploitent activement les théories du complot pour consolider leur pouvoir ; de l’autre, ils peuvent réprimer violemment les théoriciens du complot qui les dérangent. Dans de nombreux États autoritaires de la région (Syrie, Égypte, Iran, Bahreïn…), accuser les opposants d’être partie prenante d’un « complot étranger » est une stratégie de communication officielle. Par exemple, dès 2011, le régime syrien d’Assad a qualifié les manifestants de « pions d’une conspiration extérieure » pour justifier la répression sanglante trtworld.com trtworld.com. Ce discours a été inlassablement repris sur les médias d’État, instillant chez une partie de la population l’idée que la guerre civile était le fruit d’un complot occidental/israélien pour détruire la Syrie. Idem en Iran : les Gardiens de la Révolution évoquent régulièrement des « complot ourdis par la CIA et le Mossad » dès qu’il y a des troubles internes, ce qui sert à mobiliser leur base nationaliste. En ce sens, la désinformation et la propagande complotiste font partie intégrante des réponses gouvernementales au Moyen-Orient, plus qu’ailleurs. Toutefois, certains gouvernements tentent aussi de contrer les rumeurs qu’ils jugent dangereuses pour l’ordre public. L’Arabie saoudite, par exemple, a mené des campagnes religieuses pour réfuter les fatwas extrémistes diffusant des mensonges (comme l’idée que le vaccin polio était haram – Riyad a invité des oulémas à émettre des contre-fatwas affirmant la licéité et l’importance de la vaccination). De même, durant le COVID-19, plusieurs pays du Golfe ont utilisé massivement les SMS d’alerte et les influenceurs Instagram pour dissiper les rumeurs (ex : au Koweït, envoi quotidien de SMS officiels démystifiant les fausses « cures » circulant sur WhatsApp). Sur le plan répressif, la plupart des pays de la région disposent de lois contre la diffusion de fausses nouvelles. En Égypte, le simple fait de poster sur Facebook une critique de la gestion du COVID a valu des arrestations pour « publication de rumeurs nuisant à la sécurité de l’État ». En Turquie, en 2022, une loi a criminalisé la désinformation en ligne ; bien qu’elle vise surtout les opposants politiques, elle est justifiée par le gouvernement comme nécessaire pour endiguer les théories complotistes (ironiquement, le pouvoir turc lui-même a colporté par le passé des théories, comme celle d’un « intellectuel terroriste » Fethullah Gülen orchestrant en coulisse le putsch manqué de 2016). Enfin, des initiatives éducatives voient aussi le jour : l’UNESCO a collaboré avec des ONG en Tunisie et au Liban pour former des enseignants à démonter les discours complotistes (conscientisation des jeunes aux mécanismes des théories du complot). Mais ces efforts restent marginaux dans une région où bien souvent le complotisme est instrumentalisé par les dirigeants.
Impacts sur la société : Le complotisme influence profondément la cohésion régionale, la santé publique et la politique au Moyen-Orient. D’un point de vue social, il entretient un climat de suspicion et de fatalisme. De larges pans de la population, convaincus que « tout se trame en secret », développent une méfiance non seulement envers les gouvernements (qu’ils soupçonnent de leur cacher la vérité) mais aussi envers toute instance internationale. Cela nuit aux efforts de paix ou de coopération : par exemple, beaucoup d’Irakiens étant persuadés que la présence américaine depuis 2003 relevait d’un complot pour voler le pétrole, chaque projet de reconstruction ou aide étrangère a été accueilli avec doute et parfois saboté par manque de confiance. Sur le volet de la santé, les effets sont comparables à ceux décrits en Afrique et en Asie du Sud. La polio avait été éradiquée du Moyen-Orient, mais la guerre en Syrie et les rumeurs anti-vaccins ont fait réapparaître la maladie en 2013-2014 dans l’est syrien (des chefs locaux affiliés à Al-Qaïda diffusaient l’idée d’un complot empoisonné dans les vaccins fournis par l’UNICEF). De même, la campagne de vaccination COVID a tourné au casse-tête en Iran : l’interdiction des vaccins occidentaux par le Guide suprême (basée sur un discours complotiste) a retardé la vaccination de plusieurs mois en 2021, durant lesquels le variant Delta a fait des ravages. Ce n’est qu’après une mortalité élevée que l’Iran a assoupli sa position et importé massivement des vaccins – non sans que l’idéologie complotiste initiale ait coûté de nombreuses vies. Enfin, sur le plan politique, le complotisme est un frein aux transitions démocratiques et un vecteur de propagande autoritaire. Il permet aux régimes en place de délégitimer toute opposition (qualifiée d’agent de l’ennemi) et de justifier l’absence de réformes. Comme le souligne un analyste, depuis 2011 « les dirigeants menacés par des soulèvements, de Benghazi à Damas, ont joué sur une psychose victimaire », brandissant l’épouvantail du complot étranger pour ressouder leurs partisans et détourner l’attention des demandes populaires trtworld.com trtworld.com. Cela affaiblit la cohésion interne car les citoyens favorables au gouvernement croient à ces récits et se coupent de leurs compatriotes protestataires qu’ils perçoivent comme traîtres manipulés. On l’a vu en Syrie, où une partie de la population alaouite/pro-Assad a réellement cru à un complot sunnite-international contre eux, ce qui a exacerbé le caractère sectaire du conflit. Dans d’autres cas, le complotisme alimente le terrorisme : la croyance apocalyptique en un complot global contre l’islam motive des groupes djihadistes à commettre des attentats, persuadés de défendre une cause sacrée. Ainsi, on retrouve dans les manifestes de terroristes islamistes comme dans ceux d’extrémistes juifs ou chrétiens de la région un référentiel complotiste (par exemple, l’auteur de la tuerie antichiites d’Alexandrie en 2017 croyait combattre un complot américano-égyptien contre l’islam, tandis que des colons extrémistes en Cisjordanie justifient la violence en prétendant qu’il existe un complot arabe pour détruire Israël). En somme, le Moyen-Orient est pris dans un cercle vicieux où le complotisme, à la fois conséquence et outil des crises, mine la confiance, attise les haines et freine les évolutions politiques constructives.
Conclusion et études de cas
En conclusion, le complotisme est un phénomène mondial aux visages multiples, s’adaptant aux contextes culturels de chaque région. Partout, il prospère sur la méfiance, l’incertitude et les fractures sociales, et ses conséquences convergent : polarisation des sociétés, résistances sanitaires, et instrumentalisation politique. Des études de cas illustrent ces dynamiques : aux États-Unis, le cas QAnon a montré comment une théorie née en ligne a pu influencer des millions de personnes et culminer en une attaque sans précédent contre le Congrès lemonde.fr. Au Pakistan et au Nigeria, les fausses croyances autour du vaccin polio ont coûté des années de progrès sanitaire, nécessitant des réponses innovantes comme l’implication de chefs religieux pour rétablir la confiance thediplomat.com reuters.com. En France, la propagation plus limitée (mais réelle) de QAnon et du film conspirationniste Sound of Freedom a montré que même marginal, un mouvement complotiste peut infiltrer le débat public lemonde.fr. Au Moyen-Orient, la persistance de l’historique théorie du complot du 11-Septembre – trois quarts des Égyptiens n’y croient pas washingtoninstitute.org – continue d’empoisonner les relations avec l’Occident et de brouiller la compréhension des enjeux terroristes. Chaque région a dû élaborer des parades : éducation aux médias, fact-checking, discours transparents et inclusifs pour restaurer la confiance, ou hélas censure et propagande dans les régimes autoritaires, ce qui ne fait souvent qu’alimenter le problème.
En définitive, combattre le complotisme requiert de solides sources fiables et une réponse collective. Comme le préconise l’UNESCO, renforcer la résilience cognitive par l’éducation est crucial, car la tentation complotiste naît du besoin d’explications simples à des problèmes complexes unesco.org unesco.org. Les gouvernements du monde l’ont compris à des degrés divers, mais ce défi demeure global et urgent tant que le complotisme menacera la cohésion sociale, la santé des populations et le fonctionnement démocratique des États.
Sources :
- Fondation Jean-Jaurès/Ifop – Enquête sur le complotisme (2019) up-magazine.info
- Ipsos – Perils of Perception (2023) ipsos.com ipsos.com
- PRRI – QAnon Conspiracy Beliefs (2022) lemonde.fr
- Le Monde (Décodeurs) – « Des États-Unis à la France, l’imaginaire QAnon » (2023) lemonde.fr lemonde.fr
- UP’ Magazine – « Complotisme France vs USA » (2023) up-magazine.info up-magazine.info
- Abdul Basit – The Diplomat – « Conspiracy Theories in South Asia » (2024) thediplomat.com thediplomat.com
- Reuters – Nigeria fights polio vaccine myths (2016) reuters.com reuters.com
- Washington Institute – Arab Attitudes on 9/11 (2011) washingtoninstitute.org
- TRT World – Conspiracy Theories and Middle East Protests (2019) trtworld.com trtworld.com
- Alliance for Securing Democracy – China COVID disinformation (2021) securingdemocracy.gmfus.org
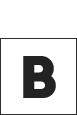


Sorry, the comment form is closed at this time.