01 Juil Évolution de la pauvreté et des inégalités économiques dans le monde depuis 1900
Introduction
La pauvreté et les inégalités économiques ont connu des transformations profondes depuis le début du XX<sup>e</sup> siècle. En 1900, la majeure partie de la population mondiale vivait dans une pauvreté extrême, tandis que les richesses étaient fortement concentrées entre les mains de quelques élites, notamment dans les puissances coloniales et les grandes économies industrialisées. Depuis, le monde a traversé des bouleversements majeurs – guerres mondiales, décolonisation, expansion sans précédent de l’économie mondiale, crises financières – qui ont remodelé la distribution des revenus et des richesses. Dans le même temps, l’intervention de l’État et les politiques publiques (du New Deal américain à la construction des États-providence en Europe, en passant par les programmes d’aide internationale) ont joué un rôle crucial pour atténuer la pauvreté et freiner les inégalités. Cet article dresse un panorama historique de l’évolution de la pauvreté et des inégalités économiques dans le monde depuis 1900, en mettant en lumière les grandes tendances quantifiables, les chocs économiques déterminants, les réponses politiques apportées et les indicateurs clés (taux de pauvreté, coefficient de Gini, part du revenu ou du patrimoine détenue par les plus riches, etc.). L’analyse met en perspective les comparaisons entre régions du monde et périodes historiques, afin de mieux comprendre comment nous sommes passés d’un monde massivement pauvre et inégal à une situation actuelle où la pauvreté extrême a fortement reculé mais où les disparités économiques restent considérables.
1. Tendances historiques de la pauvreté mondiale depuis 1900
Au début du XX<sup>e</sup> siècle, la pauvreté extrême était la condition de vie de la majorité des habitants de la planète. Des estimations historiques suggèrent qu’environ 70 % de la population mondiale vivait sous le seuil d’extrême pauvreté vers 1900 (seuil approximatif d’1 euro de 2012 par personne et par jour) blogs.histoireglobale.com. Autrement dit, les conditions de vie de la plupart des êtres humains à cette époque correspondraient aujourd’hui à ce qu’on définit comme une pauvreté absolue. Ce niveau extrêmement élevé s’explique par le fait que l’industrialisation et la croissance économique du XIX<sup>e</sup> siècle étaient encore largement limitées à une partie de l’Europe et de l’Amérique du Nord, tandis que la plupart des régions (Asie, Afrique, Amérique latine) restaient peu développées économiquement, souvent sous domination coloniale, avec de faibles revenus par habitant. On notera toutefois que les données précises sur la pauvreté mondiale au début du XX<sup>e</sup> restent des reconstructions approximatives, basées sur des estimations de revenus et de niveau de vie historiques.
Après 1950, le monde a connu une amélioration progressive mais inégale des niveaux de vie. Les décennies d’après-Seconde Guerre mondiale ont été marquées par une forte croissance économique dans les pays industrialisés et, progressivement, par le développement de nombreuses nations récemment décolonisées. En 1950, on estime qu’environ 50 % de la population mondiale vivait encore dans la pauvreté extrême, ce qui représente une diminution par rapport à 1900, mais souligne qu’une personne sur deux restait dans la misère absolue ourworldindata.org. Cette période a vu certains progrès en matière de santé, d’éducation et d’infrastructures dans les pays en développement, souvent avec le soutien d’aides internationales et d’efforts nationaux de modernisation, mais la croissance démographique rapide a maintenu un nombre élevé d’individus pauvres.
À partir des années 1980, et surtout après 1990, le recul de la pauvreté mondiale s’est nettement accéléré. La combinaison de la forte croissance en Asie de l’Est (notamment en Chine, qui a engagé des réformes économiques à partir de 1978) et en Asie du Sud (Inde, etc.), de la poursuite du développement dans d’autres régions, et de politiques internationales axées sur la réduction de la pauvreté a produit une baisse spectaculaire du taux de pauvreté. Selon les données de la Banque mondiale, la proportion d’habitants de la planète vivant sous le seuil international d’extrême pauvreté (défini à ~$1,90$ puis $2,15$ par jour, en parité de pouvoir d’achat) est passée d’environ 36-37 % en 1990 à seulement 9-10 % vers 2018-2019 inegalites.fr ourworldindata.org. En l’espace d’une génération, plus d’un milliard de personnes sont sorties de l’extrême pauvreté. Cette évolution positive signifie qu’en 2005 la proportion de personnes extrêmement pauvres était déjà tombée autour de 20 %, contre 70 % un siècle plus tôt blogs.histoireglobale.com, et a continué de baisser pour franchir le seuil de 10 % avant la pandémie de Covid-19.
Graphique 1. Évolution du nombre de personnes en situation de pauvreté extrême dans le monde (en rouge) comparé à la population non pauvre (en vert), de 1820 à 2015. La population mondiale totale a été multipliée par presque 7 en deux siècles, passant d’environ 1 milliard d’habitants en 1820 à plus de 7 milliards en 2015, mais simultanément le nombre de personnes vivant dans l’extrême pauvreté a fini par diminuer dans la seconde moitié du XX<sup>e</sup> siècle ourworldindata.org. Le pic du nombre de pauvres (zone rouge) a eu lieu vers le milieu du XX<sup>e</sup> siècle (en raison de la croissance démographique), puis la baisse du taux de pauvreté a fait reculer ce nombre absolu de 2 milliards (vers 1990) à environ 700 millions en 2015 inegalites.fr.
Il convient de souligner que cette réduction de la pauvreté mondiale est très inégale selon les régions. L’Asie de l’Est et Pacifique a connu le recul le plus spectaculaire : son taux de pauvreté extrême est passé d’environ 65 % en 1990 à 1 % en 2019, essentiellement grâce aux progrès de la Chine (qui, à elle seule, a sorti de la pauvreté des centaines de millions de personnes) et de quelques autres pays comme l’Indonésie inegalites.fr. L’Asie du Sud (incluant l’Inde, le Pakistan, le Bangladesh…) a aussi vu un déclin important, avec une proportion de pauvres tombée d’environ 50 % en 1990 à 11 % récemment inegalites.fr. En Amérique latine, le taux de pauvreté extrême, déjà plus faible au départ, a diminué de façon continue (de l’ordre de 12-15 % vers 1990 à moins de 4-5 % de nos jours, selon les données régionales).
En revanche, l’Afrique subsaharienne demeure la région la plus touchée par l’extrême pauvreté. Certes, même en Afrique, la part de la population vivant avec moins de $2,15 par jour a reculé – passant d’environ 55 % en 1990 à 37 % en 2019 – ce qui représente un progrès réel inegalites.fr. Cependant, la croissance démographique y a été telle que le nombre de personnes extrêmement pauvres en Afrique subsaharienne a augmenté durant la période, de 280 millions en 1990 à plus de 400 millions en 2019 inegalites.fr. Aujourd’hui, environ 60 % des personnes en pauvreté extrême dans le monde vivent en Afrique subsaharienne, alors que c’était l’Asie qui concentrait la majorité des pauvres il y a trente ans inegalites.fr. Le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord avaient quasiment éliminé l’extrême pauvreté (tombée sous 2 % de la population en 2011), mais les conflits récents (guerre en Syrie, instabilité) ont fait remonter ce taux autour de 5 % inegalites.fr.
Graphique 2. Part de la population vivant sous le seuil d’extrême pauvreté ($≤2,15$ USD par jour) par grande région du monde, en 1990 (barres grises) et en 2019 (barres orange). Toutes les régions du monde ont vu la pauvreté diminuer entre 1990 et 2019, mais à des rythmes différents inegalites.fr inegalites.fr. L’Asie de l’Est & Pacifique a quasiment éradiqué l’extrême pauvreté (de 65 % à 1 % de sa population), tandis que l’Afrique subsaharienne reste la plus en retard (37 % encore en pauvreté en 2019, malgré une baisse par rapport à 55 % en 1990). L’Asie du Sud est passée de 50 % à 11 %, l’Amérique latine de ~12 % à ~4 %. La région Moyen-Orient & Afrique du Nord avait fortement réduit la pauvreté (barre grise courte en 1990, <5 %), mais les conflits ont provoqué une remontée à ~5 % (barre orange) vers 2019 inegalites.fr.
En somme, la tendance historique de fond depuis 1900 est une baisse spectaculaire du taux de pauvreté mondial, surtout accélérée après 1950 et encore plus après 1990. L’humanité est passée d’un monde où l’extrême pauvreté était la norme pour la majorité, à un monde où elle ne touche plus qu’environ un dixième de la population – soit un progrès incontestable en termes de conditions de vie moyennes ourworldindata.org. Toutefois, ce succès global ne doit pas occulter les disparités persistantes : la pauvreté reste fortement concentrée dans certaines régions (Afrique notamment) et des poches de pauvreté subsistent même dans les pays riches (si l’on considère les seuils de pauvreté nationaux plus élevés). Par ailleurs, depuis la fin des années 2010, on observe un ralentissement du recul de la pauvreté : selon les estimations, depuis 2017, le taux de pauvreté mondiale stagne autour de 8-9 %, et le choc de la pandémie de Covid-19 en 2020 a même provoqué une légère remontée ponctuelle du nombre de pauvres, en particulier en Asie du Sud inegalites.fr. La lutte contre la pauvreté demeure donc un défi actuel, après deux décennies 1990-2010 qui avaient laissé espérer son éradication prochaine.
2. Tendances historiques des inégalités économiques mondiales
L’histoire des inégalités de revenus et de richesses depuis 1900 est complexe, marquée par des évolutions contrastées selon les phases historiques et les espaces géographiques. À l’échelle mondiale, les inégalités économiques peuvent être approchées de deux manières : d’une part, les écarts entre pays (les différences de revenu moyen entre nations riches et pauvres) et, d’autre part, les écarts au sein de chaque pays (inégalités internes entre individus d’une même nation). La combinaison de ces deux dimensions donne l’inégalité entre tous les habitants du globe, comme si l’on considérait l’humanité entière comme une seule société.
Au début du XX<sup>e</sup> siècle, les inégalités mondiales étaient déjà très prononcées et en hausse par rapport au siècle précédent. La révolution industrielle du XIX<sup>e</sup> siècle avait creusé un fossé entre les nations industrialisées (Europe, Amérique du Nord, Japon) devenues relativement riches, et la plupart des pays d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine restés pauvres. En conséquence, les inégalités entre pays ont explosé sur la période 1820-1910. Par exemple, en 1910 le PIB par habitant des pays les plus riches était environ 10 fois supérieur à celui des pays les plus pauvres, alors qu’il n’était que 3 fois supérieur en 1820 blogs.histoireglobale.com. Parallèlement, à l’intérieur de chaque pays, l’ère dite de la “Belle Époque” (fin XIX<sup>e</sup>-1900s) se caractérisait par de fortes inégalités de revenu et surtout de patrimoine : une petite classe de grands propriétaires fonciers et capitalistes détenait la majorité des richesses, tandis qu’une vaste population ouvrière et paysanne vivait modestement. Par exemple, en Europe vers 1900, le top 10 % des plus riches accaparait près de 50 % du revenu national chaque année, et une proportion encore plus grande du patrimoine, témoignant d’une concentration extrême des richesses fr.wikipedia.org. Des travaux de Thomas Piketty ont montré qu’en France ou au Royaume-Uni autour de 1900, le seul 1 % le plus riche détenait environ la moitié du patrimoine national, un niveau record d’inégalité patrimoniale dû à l’héritage historique d’une société de rentiers fr.wikipedia.org.
Le XX<sup>e</sup> siècle a toutefois vu d’importantes fluctuations. De manière globale, l’inégalité entre tous les citoyens du monde a augmenté pendant la majeure partie du XX<sup>e</sup> siècle, jusqu’aux années 1980, puis a commencé à reculer dans les dernières décennies. Selon l’économiste François Bourguignon, après près de deux siècles de hausse continue, l’inégalité mondiale a atteint un pic vers 1990 avant d’entamer un déclin historiqueses.ens-lyon.fr blogs.histoireglobale.com. Ce renversement récent s’explique par le fait que, depuis 1990, les écarts de revenu entre pays riches et pays en développement se sont réduits (grâce à la croissance accélérée des pays émergents d’Asie notamment), alors que simultanément les inégalités à l’intérieur de nombreux pays ont eu tendance à augmenter. Concrètement, entre 1990 et 2010, l’indice d’inégalité mondiale (coefficient de Theil) est passé d’environ 0,95 à 0,72, soit une baisse de 24 %ses.ens-lyon.fr. Le niveau d’inégalité sur l’ensemble de la planète est ainsi revenu à un niveau comparable à celui de la fin du XIX<sup>e</sup> siècleses.ens-lyon.fr. Cela signifie qu’en moyenne, les écarts de revenus entre un citoyen pris au hasard dans les pays riches et un citoyen pris au hasard dans les pays pauvres se sont réduits. On estime ainsi qu’en 2006, les 10 % les plus riches au monde gagnaient environ 90 fois plus que les 10 % les plus pauvres, alors que ce rapport aurait été encore plus élevé avant 1990 blogs.histoireglobale.com.
Cependant, cette baisse de l’inégalité mondiale récente cache un phénomène d’inversion : les inégalités entre pays ont fortement diminué (par exemple, l’essor de la Chine, de l’Inde ou d’autres économies a rapproché leur revenu moyen de celui des pays développés), mais les inégalités internes aux pays ont augmenté après des décennies de stabilitéses.ens-lyon.fr blogs.histoireglobale.com. Jusqu’aux années 1970-1980, la principale source d’inégalité mondiale était la différence de niveau de vie entre un Suédois, un Nigérian, un Indien, etc. Aujourd’hui, une part grandissante de l’inégalité se manifeste au sein de chaque société : on parle d’une “internalisation de l’inégalité mondiale”, où l’écart entre riches et pauvres se creuse à l’intérieur de chaque pays, qu’il soit développé ou en développement blogs.histoireglobale.com. Ainsi, la dispersion des revenus à l’intérieur des pays s’accroît dans de nombreuses économies depuis les années 1980, sous l’effet de la mondialisation et du changement technologique qui favorisent les plus qualifiés et le capital blogs.histoireglobale.com.
Pour mieux comprendre ces tendances, on peut examiner séparément les trajectoires des inégalités à l’intérieur des pays sur la période. Dans la plupart des pays occidentaux, le XX<sup>e</sup> siècle a dessiné une courbe en “U” des inégalités de revenu : très élevées avant la Première Guerre mondiale, elles ont nettement diminué entre les années 1914 et 1970 (période de “grande compression” des inégalités), puis ont recommencé à augmenter après les années 1980. Par exemple, aux États-Unis, la part du revenu national accaparée par les 10 % les plus riches est passée d’environ 45 % à la veille de la crise de 1929 à seulement 30-35 % dans les années 1950-1970, reflétant un fort tassement des inégalités pendant le New Deal, la Seconde Guerre mondiale et l’après-guerre fr.wikipedia.org fr.wikipedia.org. Mais à partir des années 1980, les inégalités de revenu aux États-Unis se sont envolées de nouveau : la part des 10 % les plus riches a dépassé 40 % dans les années 2000, retrouvant des niveaux proches de ceux de la fin des années 1920 fr.wikipedia.org. Des évolutions similaires ont eu lieu au Royaume-Uni, au Canada et, dans une moindre mesure, dans les pays d’Europe continentale (où l’État-providence a freiné un peu plus la hausse). Thomas Piketty et ses collègues ont documenté ces dynamiques dans de nombreux travaux : ils montrent que la période 1914-1980 a été exceptionnellement égalitaire du fait des chocs (guerres, crises) et des politiques redistributives, tandis que le retour d’une logique de marché libéralisée a recréé des disparités croissantes depuis 40 ans fr.wikipedia.org.
D’autres régions ont connu des patterns différents : en Union soviétique (et plus généralement sous les régimes communistes), les inégalités de revenu officielles étaient très faibles durant des décennies – en URSS, la part des 1 % les plus riches dans le revenu était tombée en dessous de 5 % après la révolution, contre ~17 % dans la Russie impériale de 1900 fr.wikipedia.org. Toutefois, l’égalitarisme communiste était en partie artificiel et contourné par des privilèges en nature; et après l’effondrement du bloc de l’Est en 1991, la transition vers l’économie de marché a entraîné une explosion des inégalités dans les pays post-soviétiques (Russie, etc.), souvent sous forme d’une concentration rapide du capital entre les mains d’oligarques lors des privatisations fr.wikipedia.org. En Amérique latine, région historiquement très inégalitaire, le XX<sup>e</sup> siècle est resté marqué par de fortes disparités socio-économiques, même si plusieurs pays ont connu une légère baisse des inégalités dans les années 2000 grâce à des politiques sociales (par ex. le Brésil a vu son coefficient de Gini reculer de ~0,60 en 2000 à ~0,53 en 2015). En Chine, pays pauvre mais relativement égalitaire sous Mao, l’ouverture économique après 1980 s’est accompagnée d’un creusement très rapide des écarts de revenus : le coefficient de Gini de la Chine, inférieur à 0,3 dans les années 1980, a dépassé 0,45 dans les années 2000, traduisant l’apparition d’une classe moyenne et riche prospère tandis qu’une partie de la population restait rurale et modeste.
Graphique 3. Évolution de l’inégalité des revenus au niveau mondial de 1870 à 2010, mesurée par le coefficient de Theil (courbe rouge). Ce dernier peut se décomposer en une part due aux inégalités entre pays (courbe bleue) et une part due aux inégalités à l’intérieur des pays (courbe jaune). On observe une hausse continue de l’inégalité globale jusqu’à la fin du XX<sup>e</sup> siècle, portée essentiellement par l’augmentation des écarts entre pays (montée de la courbe bleue jusqu’en ~1990) blogs.histoireglobale.com. Après 1990, la tendance s’inverse : les inégalités entre pays reculent nettement (baisse de la courbe bleue), ce qui fait diminuer l’inégalité mondiale, malgré une remontée des inégalités internes (courbe jaune en hausse)ses.ens-lyon.frses.ens-lyon.fr.
En termes d’inégalités de patrimoine (richesse accumulée sous forme d’actifs, terres, capital financier), le XX<sup>e</sup> siècle a également vu de fortes inflexions. Dans les sociétés européennes, la concentration de la richesse était extrême en 1900 (comme mentionné, une petite élite héritière possédait l’essentiel du capital). La période 1914-1945 a provoqué un écrasement de ces fortunes : destruction physique de richesses pendant les guerres, hyperinflations et crises effaçant des actifs financiers, et imposition confiscatoire des plus hauts patrimoines fr.wikipedia.org fr.wikipedia.org. En France, par exemple, la part du Top 1 % dans le patrimoine national est passée d’environ 55 % en 1910 à moins de 25 % dans les années 1980, avant de se stabiliser fr.wikipedia.org. Depuis la fin du XX<sup>e</sup> siècle, on assiste de nouveau à une hausse de la concentration patrimoniale dans de nombreux pays : aux États-Unis, le Top 1 % détient aujourd’hui près de 35-40 % de la richesse nationale (contre ~25 % dans les années 1980). Au niveau mondial, la distribution de la richesse est extrêmement inégalitaire : d’après les estimations du Crédit Suisse et d’Oxfam, 1 % seulement des adultes les plus riches possèdent près de la moitié (~50 %) de la richesse mondiale totale oxfamfrance.org, tandis que la moitié la plus pauvre de la population mondiale ne détient qu’une part infime (quelques pourcents tout au plus) des richesses. Les 10 % les plus riches accaparent environ 76 % de la richesse globale et plus de 50 % du revenu mondial imf.org. Ces chiffres vertigineux signifient que les inégalités à l’échelle planétaire, bien que légèrement réduites par la convergence entre pays, restent très élevées. L’indice de Gini mondial (mesurant l’inégalité entre tous les individus du globe) est estimé entre 0,60 et 0,70, bien supérieur à celui de n’importe quel grand pays pris isolément – signe qu’il existe toujours un fossé énorme entre les niveaux de vie des plus riches et des plus pauvres sur Terre. En résumé, le monde de 2025 est moins pauvre qu’en 1900, mais il demeure profondément inégal en termes économiques.
3. Bouleversements économiques majeurs ayant influencé pauvreté et inégalités
Plusieurs grands événements et chocs économiques survenus depuis 1900 ont profondément affecté la trajectoire de la pauvreté et des inégalités. Nous analyserons les principaux : les guerres mondiales et la Grande Dépression, la décolonisation et la Guerre froide, la mondialisation post-1980 accompagnée des crises financières récentes, ainsi que le choc de la pandémie de Covid-19.
3.1 Les guerres mondiales et la Grande Dépression (1914-1945)
La Première Guerre mondiale (1914-1918) a marqué une rupture brutale dans l’ordre économique mondial. Outre son coût humain effroyable, la guerre a entraîné une destruction massive de capital en Europe (infrastructures, habitations, usines) et d’énormes dépenses publiques militaires. Dans l’immédiat après-guerre, de nombreux pays européens ont traversé des crises économiques (hyperinflation en Allemagne 1923, récession du début des années 1920). Ces perturbations ont eu pour effet paradoxal de réduire temporairement les inégalités internes : les grandes fortunes ont été entamées par la destruction et l’inflation, tandis que les revenus des classes populaires ont été soutenus par la forte demande de main-d’œuvre pendant la guerre. Par exemple, en Allemagne, la part des 1 % les plus riches dans le patrimoine national a chuté de 1914 à 1919 du fait de l’effondrement de l’économie de guerre fr.wikipedia.org fr.wikipedia.org. Par ailleurs, l’effort de guerre s’est accompagné, dans les pays industrialisés, d’une fiscalité progressive inédite pour l’époque : vers 1920, les taux marginaux supérieurs d’imposition sur le revenu atteignaient 60-70 % dans des pays comme le Royaume-Uni ou les États-Unis, alors qu’ils étaient inférieurs à 10 % avant 1914 inegalites.fr. Ce recours massif à l’impôt sur les riches pour financer la guerre a durablement instauré le principe d’une contribution fiscale plus forte des hauts revenus (voir section 4).
La période de l’entre-deux-guerres a connu d’importantes fluctuations économiques. Les « années folles » (1920s) ont vu un boom économique et financier dans de nombreux pays (particulièrement aux États-Unis), avec un retour de la prospérité pour certains et – temporairement – un regain des inégalités (les revenus du capital rebondissant après la guerre). Cependant, la crise de 1929 et la Grande Dépression des années 1930 ont frappé de plein fouet l’économie mondiale. Le krach boursier d’octobre 1929 a pulvérisé la valeur de nombreuses entreprises et fortunes aux États-Unis (les cours boursiers ont perdu près de 90 % de leur valeur entre 1929 et 1932). Le chômage de masse (jusqu’à 25 % de la population active aux USA en 1933) et la chute des revenus qui ont suivi ont fait basculer dans la pauvreté des millions de personnes, y compris dans les pays avancés. En 1932, aux pires heures de la Dépression, plus de 20 % de la population américaine vivait sous le seuil de pauvreté américain, contre environ 12 % à la fin des années 1920 (estimation). Partout, les plus pauvres ont souffert de la faim et de la précarité, comme en témoignent les « Hoovervilles », ces bidonvilles de sans-abri aux États-Unis. Néanmoins, en termes d’inégalités, la Grande Dépression a eu pour effet de réduire fortement les écarts de revenus dans les pays riches : les plus riches ont vu leurs revenus chuter davantage (avec l’effondrement des profits et dividendes) que les classes moyennes et pauvres, dont le revenu principal – le salaire – a été en partie soutenu par des politiques publiques après 1933. Ainsi, aux États-Unis, de 1929 à 1933, le revenu moyen du top 1 % a baissé de plus de 50 %, nettement plus que le revenu médian, ce qui a ramené la part du top 1 % dans le revenu national de ~24 % (1928) à ~16 % (1935) selon les données historiques fr.wikipedia.org fr.wikipedia.org. Dans le même temps, face à l’urgence sociale, de nouvelles politiques ont été mises en place (cf. New Deal plus bas), amorçant la construction d’un filet de sécurité pour les plus démunis.
La Seconde Guerre mondiale (1939-1945) fut un cataclysme encore plus vaste, mobilisant l’économie de presque tous les continents. Sur le plan de la production, l’effort de guerre a créé le plein emploi dans les pays engagés (résorbant du même coup la grande pauvreté dans ces pays pendant la guerre, bien que par des moyens tragiques). Par contre, les combats ont ravagé l’Europe, une partie de l’Asie et l’Afrique du Nord : des villes entières détruites, des infrastructures à reconstruire. Au lendemain de 1945, l’Europe et le Japon étaient exsangues, avec des populations appauvries et parfois menacées de famine (hivers 1945-46 très rudes). Les inégalités économiques ont de nouveau été fortement réduites par la guerre : la destruction d’environ 11 % du patrimoine total de l’Allemagne par exemple (bombardements, etc.) a frappé surtout les propriétaires (les bâtiments, usines et actions détenus par les classes aisées) et conduit à un rapprochement du niveau de vie entre classes sociales fr.wikipedia.org fr.wikipedia.org. En même temps, la guerre a poussé les gouvernements à accentuer la fiscalité progressive à des sommets historiques (le président Roosevelt aux États-Unis a imposé un taux marginal de 94 % sur les très hauts revenus en 1944-45) inegalites.fr. Cet écrasement fiscal des plus riches a perduré en partie après-guerre. Enfin, l’expérience de la guerre a entraîné, dans de nombreux pays, une prise de conscience politique en faveur de plus de justice sociale (le slogan du « Plus jamais ça » incluait l’idée de construire des sociétés d’après-guerre plus égalitaires, pour éviter le chaos). Ainsi, paradoxalement, la période de guerre et d’immédiat après-guerre, bien que terrible humainement, a jeté les bases d’une réduction durable des inégalités dans les pays occidentaux et d’une baisse de la pauvreté avec la reconstruction, notamment grâce aux innovations sociales adoptées durant ou juste après le conflit.
3.2 Décolonisation, croissance des Trente Glorieuses et Guerre froide (1945-1975)
L’après-Seconde Guerre mondiale a été marqué par deux dynamiques majeures : la décolonisation d’une grande partie de l’Asie et de l’Afrique, et la période de croissance exceptionnelle des « Trente Glorieuses » dans les pays occidentaux (1945-1975). Ces transformations ont eu des effets contrastés sur la pauvreté et les inégalités au niveau mondial.
D’une part, la décolonisation a vu l’émergence de dizaines de nouvelles nations indépendantes à travers le monde (Inde et Pakistan en 1947, quasiment toute l’Asie du Sud-Est dans les années 1940-50, la plupart des colonies africaines dans les années 1950-60). Ces nouveaux États ont hérité de structures économiques souvent fragiles, basées sur l’exportation de matières premières, avec de faibles niveaux d’industrialisation et des populations majoritairement rurales et pauvres. Dans certains cas, l’indépendance s’est accompagnée de conflits ou guerres civiles, aggravant la situation (ex : Congo belge, Indochine/Vietnam, partition de l’Inde…). Néanmoins, la décolonisation a aussi permis à ces pays de prendre en main leurs politiques de développement. Dès les années 1950 et 1960, beaucoup ont investi dans l’éducation, la santé, les infrastructures, souvent avec l’aide de l’ONU ou de l’aide bilatérale (voir section 4.4). Des progrès notables ont été enregistrés en termes d’alphabétisation, de baisse de la mortalité infantile, etc., posant les bases d’une réduction future de la pauvreté. Sur le plan des inégalités internes, certains pays nouvellement indépendants ont entrepris des réformes agraires ou nationalisé des ressources pour casser les anciennes structures coloniales très inégalitaires (ex : l’Éthiopie après 1974, l’Inde a aboli les “états princiers” féodaux). Cependant, beaucoup de nations post-coloniales sont restées très inégalitaires, notamment en Amérique latine où l’indépendance était ancienne mais les élites traditionnelles ont conservé le pouvoir économique (les grandes propriétés terriennes, etc., sont restées en place dans nombre de pays). Globalement, dans les décennies 1950-70, l’écart de revenu entre pays développés et pays en développement s’est encore creusé : le monde était divisé entre un « Nord » riche et industrialisé et un « Sud » global plutôt pauvre. En 1970, le PIB par habitant des pays d’Amérique du Nord ou d’Europe occidentale était plus de 10 fois supérieur à celui de la plupart des pays d’Afrique subsaharienne ou d’Asie du Sud. Cet accroissement des inégalités entre nations a contribué au pic d’inégalité mondiale mentionné plus haut blogs.histoireglobale.com.
D’autre part, les décennies d’après-guerre ont été l’âge d’or de la croissance économique dans les pays occidentaux et au Japon. Les Trente Glorieuses (1945-1975) ont vu des taux de croissance du PIB de l’ordre de +5 % par an en Europe de l’Ouest, au Japon et au Canada, +3-4 % aux États-Unis, ce qui a entraîné un quasi quadruplement du niveau de vie moyen en une génération dans ces pays. Cette prospérité sans précédent s’est accompagnée de la mise en place ou du renforcement de l’État-providence : assurances sociales généralisées (chômage, retraite, santé), investissements publics massifs (éducation de masse, logements, infrastructures) et fiscalité redistributive élevée. Ces politiques, combinées au plein emploi, ont eu pour effet de réduire fortement la pauvreté dans les pays développés (le phénomène des “working poors” était très limité, les salaires réels augmentant pour tous) et de maintenir les inégalités à des niveaux historiquement bas. On parle de “grande compression” : entre 1945 et 1980 environ, les écarts de revenus sont restés contenus dans la plupart des économies avancées fr.wikipedia.org inegalites.fr. Par exemple, en France dans les années 1960, le rapport interdécile (entre le revenu des 10 % les plus riches et des 10 % les plus pauvres) était d’environ 7, bien plus faible qu’il ne l’était en 1900. La pauvreté absolue avait pratiquement disparu dans ces sociétés riches : les personnes disposant de très faibles revenus étaient soutenues par la protection sociale, si bien que la misère extrême était rare (les problèmes qui subsistaient relevaient davantage de pauvreté “relative” ou d’exclusion sociale ponctuelle). En résumé, pour la partie du monde “occidentale” (y compris Japon, Australie…), la période de l’après-guerre jusqu’aux années 1970 a été celle d’une réduction maximale des inégalités internes et d’une prospérité partagée, ce qui a conduit certains historiens à qualifier le XX<sup>e</sup> siècle de “court siècle de l’égalité” concentré sur ces décennies inegalites.fr inegalites.fr.
Parallèlement, la Guerre froide (1947-1991) a influencé indirectement la lutte contre pauvreté et inégalités. La compétition idéologique entre le bloc capitaliste conduit par les États-Unis et le bloc communiste conduit par l’URSS a poussé chaque camp à essayer de gagner les “cœurs et esprits” dans le tiers-monde en promouvant son modèle de développement. Les États-Unis et leurs alliés ont investi dans l’aide économique aux pays en développement (Point Four program de Truman, Plan Colombo en Asie, Alliance for Progress en Amérique latine, etc.) pour contrer l’attrait du communisme. L’Union soviétique de son côté soutenait des mouvements socialistes dans le tiers-monde et offrait une assistance technique à certains pays nouvellement indépendants. Cette rivalité a parfois bénéficié aux pays récipiendaires en leur donnant accès à des financements ou des technologies (ex : le barrage d’Assouan en Égypte financé par l’URSS). Toutefois, la Guerre froide a aussi engendré des conflits régionaux (Vietnam, Angola, Afghanistan, etc.) qui ont dévasté des économies locales et maintenu des populations dans la pauvreté. En outre, la pression du modèle communiste a pu inciter les élites occidentales à maintenir un haut niveau de bien-être ou d’égalité sociale pour prouver la supériorité du modèle capitaliste démocratique (d’où l’acceptation de l’État-providence, de réformes comme les droits civiques, etc., pour éviter des révoltes). Ainsi, on peut dire que la peur du communisme a été un facteur encourageant la redistribution dans de nombreux pays occidentaux d’après 1945 fr.wikipedia.org.
3.3 Mondialisation néolibérale et crises financières (1975-2000)
Le tournant des années 1970-1980 a enclenché une nouvelle phase marquée par l’approfondissement de la mondialisation économique d’une part, et par un changement d’orientation des politiques économiques (le virage “néolibéral”) d’autre part. Ces évolutions, conjuguées à plusieurs crises, ont eu un impact majeur sur les niveaux de vie relatifs et la distribution des revenus.
Les années 1970 ont été d’abord marquées par les chocs pétroliers de 1973 et 1979. La flambée des prix du pétrole a provoqué stagflation et récession dans les pays importateurs et, indirectement, une crise de la dette dans le tiers-monde : de nombreux pays en développement, endettés pendant la période d’argent facile des 60s, ont vu leurs charges d’intérêts exploser à cause de la hausse des taux d’intérêt américains après 1979 (politique monétaire de Paul Volcker) combinée à la baisse de leurs recettes d’exportation. Ainsi, les années 1980 ont été qualifiées de « décennie perdue » pour l’Amérique latine et l’Afrique subsaharienne, en raison de la crise de la dette : le remboursement forcé des emprunts a conduit à des plans d’ajustement structurel sous l’égide du FMI, se traduisant par des coupes budgétaires drastiques, des dévaluations et la suppression de nombreuses subventions. Ces mesures ont souvent aggravé la pauvreté à court terme (réduction des dépenses sociales, hausse du coût de la vie) et creusé les inégalités dans les pays débiteurs. Par exemple, au Mexique ou au Brésil, les années 1980 ont vu le revenu par habitant stagner voire reculer, et la pauvreté toucher de nouvelles franges de la population urbaine. En Afrique, la combinaison de la crise économique et de l’instabilité politique a fait augmenter le nombre de personnes vivant avec moins d’un dollar par jour pendant cette période.
Dans les pays développés, le milieu des années 1970 sonne la fin des Trente Glorieuses. Le chômage de masse réapparaît (dès 1975-77, plus de 5 % de chômeurs en Europe, taux inouï depuis les années 1930) et la croissance économique ralentit nettement. Cette conjoncture, ajoutée à une évolution idéologique, conduit à un changement de doctrine économique à partir de 1979-1980, symbolisé par l’arrivée au pouvoir de Margaret Thatcher au Royaume-Uni (1979) et de Ronald Reagan aux États-Unis (1981). Le néolibéralisme – prônant la dérégulation, la réduction du rôle de l’État dans l’économie, les privatisations et des baisses d’impôts – remplace le consensus keynésien précédent. Concrètement, les années 1980-90 voient : la dérégulation des marchés financiers (abolition du Glass-Steagall Act, Big Bang de la City 1986), la libéralisation du commerce mondial (Cycle de l’Uruguay du GATT, accords de libre-échange), la privatisation de nombreuses entreprises publiques (en Europe surtout), et un recul de la progressivité fiscale (les taux marginaux supérieurs d’imposition passent de ~70 % à ~28 % aux États-Unis entre 1970 et 1988, des baisses analogues se produisent au Royaume-Uni, en Allemagne, etc.). Ces politiques ont été justifiées par la nécessité de relancer la croissance et l’investissement, mais elles ont eu pour corollaire un accroissement des inégalités de revenus : la part des revenus du travail allant aux salariés moyens stagne, tandis que celle captée par les plus hauts salaires et surtout par les revenus du capital augmente. Les syndicats, affaiblis (déclin de la syndicalisation, lois anti-grève), ne parviennent plus à obtenir des hausses de salaires proportionnelles aux gains de productivité. Dans les pays anglo-saxons, cette période a vu une polarisation des revenus : en termes réels, le revenu des plus pauvres a peu progressé voire reculé, tandis que celui du Top 1 % a explosé (notamment grâce aux bonus financiers, stock-options, etc.). Résultat : à la fin des années 1990, les inégalités internes dans des pays comme les États-Unis ou le Royaume-Uni retrouvaient des niveaux qui n’avaient plus été observés depuis les années 1920 fr.wikipedia.org. Dans d’autres pays occidentaux, la hausse a été plus modérée, mais la tendance générale allait dans le même sens.
La mondialisation commerciale et financière a également eu des effets ambivalents. D’un côté, l’intégration des économies a favorisé la croissance dans de nombreux pays en développement à partir des années 1990 : c’est l’émergence des “Nouveaux pays industrialisés” (NPI) d’Asie – la Corée du Sud, Taïwan, Singapour, Hong Kong dès les 70s-80s, puis la Chine, l’Inde, l’Indonésie, le Vietnam dans les 90s-2000s. Ces pays ont profité des investissements étrangers, du transfert de technologies et de l’accès aux marchés occidentaux pour doper leur production industrielle et créer des millions d’emplois. Cela a engendré la sortie de la pauvreté de masses considérables de population (comme décrit en section 1). En ce sens, la mondialisation a été un puissant moteur de réduction de la pauvreté globale. D’un autre côté, la mise en concurrence internationale a exercé des pressions sur les travailleurs peu qualifiés des pays riches (concurrence des salaires bas à l’étranger, délocalisations) et, simultanément, a creusé des écarts au sein des pays émergents (par exemple entre zones côtières industrialisées et campagnes reculées en Chine). Globalement, la mondialisation a eu tendance à diminuer les inégalités entre pays (les pays pauvres rattrapant partiellement les riches) mais à accroître les inégalités internes dans beaucoup de pays, comme l’analyse Bourguignon blogs.histoireglobale.com blogs.histoireglobale.com.
Enfin, les crises financières ponctuelles de la fin du XX<sup>e</sup> siècle ont touché certaines régions de plein fouet. La crise asiatique de 1997-98 a brutalement interrompu la croissance de pays d’Asie du Sud-Est (Thaïlande, Indonésie, Corée du Sud, Malaisie) : monnaies en chute libre, faillites bancaires, récession. Des millions de personnes sont retombées temporairement dans la pauvreté, surtout en Indonésie où le nombre de pauvres a bondi de 22 millions (1997) à 49 millions (1998) selon la Banque mondiale. Cependant, ces pays se sont relevés assez vite et ont repris leur trajectoire de développement, aidés par des plans du FMI et des réformes. La crise financière russe de 1998 a ruiné l’épargne de nombreux Russes (dévaluation du rouble, inflation) et accentué encore les inégalités déjà énormes de la Russie post-soviétique. En Argentine, l’effondrement économique de 2001 a plongé la moitié de la population sous le seuil de pauvreté dans un pays pourtant à revenu intermédiaire. Ces épisodes illustrent comment la volatilité financière peut faire vaciller des classes moyennes fragiles et générer une nouvelle pauvreté conjoncturelle. Ils ont conduit les organisations internationales à mieux prendre en compte la dimension sociale et à promouvoir des filets de protection (par ex. les “filets sociaux” financés par la Banque mondiale après 2000).
3.4 Tendances récentes (2000-2025) et chocs du début du XXI<sup>e</sup> siècle
Le début du XXI<sup>e</sup> siècle a prolongé les tendances de la fin du XX<sup>e</sup> : une mondialisation toujours plus poussée (entrée de la Chine à l’OMC en 2001, expansion du commerce international, révolution numérique), accompagnée de gains économiques substantiels dans de nombreux pays émergents, mais aussi d’une montée des inégalités et de nouveaux défis globaux.
Sur le plan de la pauvreté, les années 2000-2015 ont été une période faste en termes de réduction de la pauvreté extrême, comme nous l’avons vu (passage de ~26 % à ~9 % de la population mondiale en pauvreté extrême). Cette période correspondait aux Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) de l’ONU, dont le premier objectif était de réduire de moitié la proportion de personnes en extrême pauvreté entre 1990 et 2015 – objectif qui a été atteint et même dépassé au niveau mondial, principalement grâce aux progrès en Asie inegalites.fr inegalites.fr. Cependant, à partir de 2015, on constate un ralentissement : les derniers bastions de pauvreté sont plus difficiles à éradiquer, notamment en Afrique subsaharienne où les progrès stagnent. Les Objectifs de Développement Durable (ODD) adoptés en 2015 visent à éliminer totalement l’extrême pauvreté d’ici 2030, mais les projections actuelles indiquent qu’en l’absence de mesures supplémentaires, plusieurs centaines de millions de personnes pourraient encore demeurer en pauvreté en 2030, surtout en Afrique et dans certains États fragiles.
En termes d’inégalités, la période récente a exacerbé certaines disparités. La prospérité économique a continué de bénéficier de manière disproportionnée aux plus aisés : par exemple, depuis 1980, les 1 % les plus riches du monde ont capté 27 % de la croissance totale des revenus, tandis que les 50 % les plus pauvres n’en ont perçu que 12 % oxfamfrance.org. L’essor des entreprises technologiques et la globalisation de la finance ont créé des concentrations de richesse inédites – on a vu apparaître des centaines de nouveaux milliardaires, notamment en Asie. Selon un rapport Oxfam, les milliardaires du monde ont vu leur fortune cumulée augmenter de 5 400 milliards de dollars (en valeur réelle) entre 1987 et 2013 fr.wikipedia.org. La part du patrimoine mondial détenue par les milliardaires est passée de 0,4 % en 1987 à plus de 1,5 % en 2013 fr.wikipedia.org, signe d’une concentration extrême au sommet. De tels chiffres suggèrent que, sans interventions, le capitalisme contemporain tend à reconduire des niveaux d’inégalités patrimoniales comparables à ceux de la Belle Époque (selon l’analyse de Piketty). Ces dynamiques suscitent des débats politiques intenses sur la taxation des ultra-riches, l’évasion fiscale internationale, ou l’instauration d’un impôt sur la fortune mondial.
Deux grands chocs mondiaux récents ont également affecté la trajectoire : la crise financière mondiale de 2008 et la pandémie de Covid-19 en 2020. La crise de 2008, partie du krach des subprimes aux États-Unis, a entraîné la pire récession mondiale depuis 1945. Des dizaines de millions de personnes ont perdu leur emploi en 2008-2009, particulièrement dans les pays développés. Cela a provoqué une hausse transitoire du chômage et de la pauvreté (par exemple en Espagne le taux de pauvreté relative est passé de 20 % à 26 % entre 2008 et 2014). Néanmoins, dans la plupart des pays riches, l’existence d’allocations chômage et de stabilisateurs sociaux a amorti le choc pour les plus modestes. Les inégalités de revenus se sont parfois réduites très légèrement durant la récession (les revenus des plus riches étant dépendants des marchés financiers qui se sont effondrés), mais l’effet fut de courte durée : dès 2010, la reprise économique – alimentée par des plans de sauvetage publics et une politique monétaire ultra-accommodante – a surtout profité aux détenteurs d’actifs. On a ainsi observé une situation quelque peu ironique où, quelques années après la crise, les écarts de richesse s’étaient encore creusés (les patrimoines financiers ayant rebondi fortement grâce aux liquidités des banques centrales, favorisant ceux qui possèdent des actions et de l’immobilier). En somme, la crise de 2008 a probablement renforcé le sentiment d’injustice (sauvetage des banques vs austérité pour la population dans certains pays) et mis en lumière l’importance de la régulation financière pour prévenir des chocs qui frappent in fine les plus vulnérables.
La crise du Covid-19 en 2020-2021 a été un événement sans précédent par sa nature sanitaire, mais avec de lourdes conséquences économiques. Les mesures de confinement ont provoqué un arrêt brutal de l’activité dans de nombreux secteurs (tourisme, restauration, commerce, usines fermées…). Le PIB mondial a chuté en 2020, et le nombre de personnes en pauvreté extrême a augmenté pour la première fois depuis des décennies, de l’ordre de +100 millions supplémentaires selon la Banque mondiale. La pandémie a frappé plus durement les travailleurs informels et précaires, sans épargne ni protection sociale, notamment dans les pays en développement. Par exemple, en Inde, des millions de travailleurs migrants privés de revenus ont dû retourner dans leurs villages faute de pouvoir subsister en ville. Grâce aux aides d’urgence déployées dans de nombreux pays (transferts monétaires, distribution alimentaire, etc.), une catastrophe humanitaire plus large a pu être évitée, mais une partie de ces nouveaux pauvres risquent de le rester plusieurs années. En outre, la reprise post-2020 a été inégale : les pays riches, ayant vacciné rapidement et injecté des plans de relance massifs, ont rebondi économiquement, tandis que beaucoup de pays du Sud peinent à retrouver leur trajectoire d’avant-crise. Les inégalités internationales pourraient s’en trouver accrues à court terme. Au sein des pays, on a constaté que les plus fragiles (jeunes, femmes, minorités) ont subi les plus fortes pertes d’emplois, tandis que certaines grandes fortunes ont profité du contexte (ex: les actionnaires des géants du numérique ou de la pharmacie). Ainsi, Oxfam notait que les 10 hommes les plus riches du monde ont vu leur fortune globale augmenter d’environ 500 milliards de dollars pendant la première année de la pandémie, illustrant une fois de plus la dissociation entre la sphère financière et l’économie réelle pour la majorité. En 2022-2023, l’inflation mondiale (liée à la reprise et aux chocs d’offre, notamment la guerre en Ukraine) est venue frapper surtout les ménages modestes en érodant leur pouvoir d’achat, ce qui constitue un défi supplémentaire pour la pauvreté dans de nombreux pays.
En somme, la période 2000-2025 a été riche en événements influant sur la pauvreté et les inégalités : progression soutenue puis stagnation de la réduction de la pauvreté, montée des inégalités au sein de nombreux pays, et crises globales successives. L’histoire récente démontre l’importance de la résilience des systèmes de protection sociale face aux chocs et la nécessité d’une coopération internationale pour juguler les retombées sur les plus vulnérables.
4. Politiques publiques influentes dans la réduction de la pauvreté et des inégalités
Les évolutions décrites n’ont pas été le fruit du seul “main invisible” de l’économie : les politiques publiques ont joué un rôle central pour atténuer ou accentuer la pauvreté et les inégalités au fil du temps. Cette section examine quelques grandes réponses politiques qui ont marqué le siècle : l’instauration de l’impôt progressif et le New Deal durant la crise des années 1930, la construction de l’État-providence après la Seconde Guerre mondiale, le tournant des réformes néolibérales à partir des années 1980, et enfin les programmes d’aide internationale et de développement visant à combattre la pauvreté à l’échelle mondiale.
4.1 Instauration de l’impôt progressif et New Deal (années 1900-1930)
Au début du XX<sup>e</sup> siècle, la plupart des États ne disposaient pas encore d’outils fiscaux modernes pour redistribuer les richesses. La période 1900-1930 a vu l’émergence de l’impôt progressif sur le revenu comme instrument majeur de réduction des inégalités. Le Royaume-Uni adopte un impôt sur le revenu progressif en 1909, suivi des États-Unis en 1913 (16<sup>e</sup> amendement) et de la France en 1914 inegalites.fr. Au départ, les taux étaient modestes (quelques pourcents sur les hauts revenus) et concernaient une minorité de contribuables aisés. Mais sous l’effet des circonstances (guerre de 14-18, puis crise de 1929), ces impôts sont vite devenus beaucoup plus lourds : ainsi, vers 1920, les tranches supérieures atteignaient 60-70 % dans plusieurs pays, un niveau inimaginable seulement dix ans auparavant inegalites.fr. Cette révolution fiscale a eu pour effet direct de limiter l’accumulation de revenus par l’élite et de fournir des recettes pour financer des dépenses sociales naissantes. Par exemple, les recettes de l’impôt ont permis d’indemniser les anciens combattants, de lancer des programmes de logements sociaux dans l’entre-deux-guerres, etc. En parallèle, certains pays ont instauré des droits de succession progressifs, frappant les héritages importants afin d’éviter le perpétuel reconduction des grandes fortunes familiales inegalites.fr.
Lors de la Grande Dépression des années 1930, face à l’explosion du chômage et de la pauvreté aux États-Unis, le président Franklin D. Roosevelt a lancé le New Deal (1933-1938), une série de réformes économiques et sociales sans précédent pour l’époque. Parmi les mesures du New Deal figurent la création de grands travaux publics (pour employer les chômeurs), la mise en place d’un salaire minimum fédéral, la protection du droit syndical (National Labor Relations Act 1935) – autant de dispositions qui visaient à protéger les travailleurs et à relever leurs revenus. Surtout, une avancée majeure a été le Social Security Act de 1935, qui a introduit pour la première fois aux États-Unis une assurance vieillesse (retraite publique), une assurance chômage et une assistance aux familles démunies inegalites.fr. Ce socle de protection sociale, très inspiré du modèle bismarckien allemand, a permis à des millions d’Américains âgés ou vulnérables de sortir de la misère. Même si le New Deal n’a pas éliminé la pauvreté (le plein emploi ne reviendra vraiment qu’avec l’effort industriel de la Seconde Guerre mondiale), il a nettement amélioré la situation de nombreuses familles et réduit l’angoisse du lendemain. Par ailleurs, Roosevelt a accentué la fiscalité progressive : en 1932, le taux supérieur de l’impôt sur le revenu américain était porté à 63 %, puis à 79 % en 1936 ; en 1944, il sera porté jusqu’à 94 % pour financer la guerre inegalites.fr. Cette fiscalité confiscatoire sur les très hauts revenus, combinée à de nouvelles taxes sur les entreprises (ex: impôt sur les bénéfices non distribués en 1936), a contribué à une réduction drastique des inégalités de revenu aux États-Unis durant cette période. D’autres pays, sans utiliser le terme de “New Deal”, ont entrepris des politiques similaires de lutte contre la crise et la pauvreté dans les années 1930 – par exemple, la France du Front Populaire (1936-38) a introduit les premières congés payés, une semaine de 40 heures, et amélioré la couverture sociale des travailleurs urbains.
En résumé, la période de l’entre-deux-guerres a vu les premiers outils modernes de redistribution se mettre en place : impôts progressifs, programmes sociaux embryonnaires, réglementation du travail. Ces politiques ont jeté les bases de l’État-providence d’après-guerre et ont prouvé qu’il était possible, via l’action publique, de corriger substantiellement les inégalités générées par le marché libre fr.wikipedia.org fr.wikipedia.org.
4.2 L’essor de l’État-providence et la réduction des inégalités (1945-1980)
Après la Seconde Guerre mondiale, nombre de pays ont institutionnalisé et élargi les mécanismes de solidarité. C’est l’âge d’or de l’État-providence, avec l’objectif explicite de lutter contre la pauvreté et l’insécurité économique de la “cradle to grave” (du berceau à la tombe). En Europe occidentale, sous l’impulsion de gouvernements de centre-gauche (travaillistes en Grande-Bretagne, démocrates-chrétiens ou sociaux-démocrates ailleurs) et avec le consensus de larges pans de la population, on assiste à la généralisation des systèmes de sécurité sociale : assurance maladie universelle (ex: création du NHS britannique en 1948, Sécurité sociale en France en 1945), régimes de retraites étendus à tous les salariés (et plus tard aux agriculteurs), assurance chômage renforcée, allocations familiales pour soutenir les ménages avec enfants, aide sociale pour les personnes sans ressources, etc. Ces transferts sociaux ont eu un impact massif sur la réduction de la pauvreté dans les pays industrialisés : par exemple, il est bien documenté qu’en l’absence de transferts publics, le taux de pauvreté relative serait deux à trois fois plus élevé dans la plupart des pays d’Europe que ce qu’il est effectivement. Les personnes âgées, en particulier, ont vu leur sort transformé – alors qu’avant-guerre, la vieillesse s’accompagnait souvent de la misère faute de revenu, les retraites publiques ont quasiment éradiqué la pauvreté des seniors dans la plupart des pays développés dès les années 1960-70 inegalites.fr.
Parallèlement, les politiques économiques keynésiennes ont visé le plein emploi, condition cruciale pour minimiser la pauvreté par le travail. Les gouvernements intervenaient activement pour stimuler la demande en cas de ralentissement (dépenses publiques, soutien aux revenus) et réguler la conjoncture. La période a connu des taux de chômage très faibles (souvent < 3 % en Europe dans les années 60), ce qui signifie peu de foyers sans revenu du travail. De plus, la croissance élevée facilitait la hausse des salaires réels, laquelle était souvent négociée dans le cadre d’un dialogue social institutionnalisé (conventions collectives, syndicats puissants obtenant des augmentations en ligne avec la productivité). Ainsi, la classe ouvrière et la classe moyenne ont vu leur pouvoir d’achat croître fortement, resserrant l’écart avec les classes supérieures dont les revenus, eux, étaient bridés par de hauts impôts.
Un indicateur du succès de ces politiques est l’augmentation drastique des dépenses sociales sur PIB au cours du XX<sup>e</sup> siècle. En France, Allemagne ou Italie, les dépenses publiques à vocation sociale représentaient à peine 2 % du PIB vers 1900, alors qu’au début du XXI<sup>e</sup> siècle elles atteignent 25-30 % du PIB dans ces mêmes pays inegalites.fr. Cette expansion traduit les efforts considérables consentis pour l’éducation de masse, la santé publique (vaccinations, hôpitaux accessibles à tous), le logement social et la lutte contre la précarité. Par exemple, la scolarisation secondaire et supérieure de larges pans de la population a permis une mobilité sociale ascendante, offrant à des enfants de milieux modestes la possibilité d’accéder à des emplois qualifiés mieux rémunérés que ceux de leurs parents, ce qui a diminué les inégalités intergénérationnelles.
Enfin, il faut noter que ce consensus égalitariste de l’après-guerre était soutenu par plusieurs facteurs politiques : l’expérience de l’unité nationale pendant la guerre, la présence d’un bloc communiste rival qui poussait l’Ouest à montrer un “capitalisme à visage humain”, et la démocratisation (droit de vote des classes populaires et des femmes, qui a favorisé les partis pro-bien-être social). Les élites économiques ont accepté des compromis redistributifs par crainte de révolutions ou simplement parce que la prospérité globale profitait finalement aussi aux industriels (société de consommation de masse). Ce contrat social a fonctionné durant trois décennies, produisant ce que certains économistes ont appelé la “grande compression” : entre les années 1930 et 1970, les écarts de revenus ont atteint un plancher historique dans les pays capitalistes avancés fr.wikipedia.org. Les sociétés étaient plus égalitaires non seulement en revenus, mais aussi en accès aux services essentiels (la santé, l’éducation devenant des droits), ce qui a des effets à long terme sur la réduction des inégalités d’opportunités.
4.3 Réformes fiscales néolibérales et remise en cause de la redistribution (1980-2000)
Le tournant des années 1980 a vu un retour en force des idées libérales dans la conduite des politiques publiques, avec des conséquences notables sur la répartition des richesses. Sous l’influence des économistes monétaristes et néoclassiques, de nombreux gouvernements ont estimé que l’État-providence était devenu trop coûteux et qu’il pénalisait la croissance. Il y a donc eu des efforts pour réduire la fiscalité sur les hauts revenus et le capital, pour encourager l’investissement et la création de richesse en haut de la pyramide (théorie du “ruissellement”). Par exemple, aux États-Unis, l’administration Reagan a ramené l’impôt fédéral sur le revenu à seulement 28 % au maximum en 1988 (contre 70 % en 1980) – un changement radical inegalites.fr. Des réductions similaires ont eu lieu au Royaume-Uni sous Thatcher (le taux supérieur passe de 83 % à 40 % entre 1979 et 1988). On a aussi allégé l’imposition des successions, supprimé des taxes sur la fortune (la France a même supprimé puis rétabli par intermittence l’impôt sur les grandes fortunes). Ces baisses d’impôts ont mécaniquement augmenté les revenus nets des plus riches et affaibli la capacité redistributive de l’État. En parallèle, des réformes du marché du travail ont visé plus de flexibilité : facilité accrue des licenciements, diminution du pouvoir de négociation des syndicats, ce qui a pu contribuer à une stagnation des salaires pour les moins qualifiés.
Les dépenses sociales, dans certains pays, ont été contenir ou réduites par des politiques d’austérité ou de rationalisation : augmentation de l’âge de la retraite, resserrement de l’éligibilité à certaines aides, privatisations dans la santé ou les transports qui ont rendu certains services plus chers. Par exemple, la réforme de l’aide sociale américaine en 1996 (sous Clinton) a limité la durée des prestations et introduit des conditions de travail obligatoires, entraînant une baisse du nombre de bénéficiaires, certes dans un contexte de forte croissance où beaucoup ont retrouvé un emploi, mais cela a aussi laissé de côté une frange de pauvres non éligibles. En Europe, les contraintes budgétaires (critères de Maastricht dans les années 90) ont incité plusieurs pays à freiner l’augmentation des prestations. Globalement, sans démanteler l’État-providence, on a observé un glissement vers un modèle plus “résiduel” ou ciblé sur les plus pauvres, et moins universaliste qu’auparavant.
L’effet conjugué de ces politiques a été, comme discuté, une augmentation marquée des inégalités de revenus dans la plupart des pays avancés après 1980. Les riches ont bénéficié de la mondialisation et des réformes (ils payent moins d’impôts et peuvent capter une part plus grande des gains de l’entreprise), tandis que les classes moyenne et populaire ont subi la concurrence internationale (pression à la modération salariale, délocalisations) et la moindre générosité redistributive de l’État. Par exemple, en États-Unis, le coefficient de Gini est passé d’environ 0,37 en 1980 à 0,45 en 2000, reflétant une société nettement plus inégalitaire. En Royaume-Uni, le Gini est passé de ~0,27 à ~0,34 sur la même période. Même dans les pays scandinaves, connus pour leur égalité, les inégalités ont légèrement augmenté dans les années 1990 suite à des coupes budgétaires et à la crise bancaire du début de la décennie.
Sur le plan fiscal, la concurrence fiscale internationale est devenue un phénomène : pour attirer les capitaux et les hauts revenus, de nombreux pays ont réduit leurs impôts et parfois créé des niches. Ceci a compliqué la taxation des multinationales et des très riches, qui pouvaient plus aisément optimiser fiscalement (paradis fiscaux, etc.). Cette érosion de la base fiscale des États a pu limiter les moyens disponibles pour des politiques sociales ambitieuses. Thomas Piketty souligne qu’entre 1980 et 2020, le monde a dans l’ensemble allégé la charge fiscale des plus riches en escomptant des effets de croissance, sans obtenir de preuve décisive que cela ait dopé l’économie, alors que l’effet sur les inégalités est lui bien réel fr.wikipedia.org. Dans son ouvrage Le Capital au XXI<sup>e</sup> siècle, il plaide pour un impôt progressif sur le capital au niveau mondial pour contrer la dynamique naturelle d’accumulation qui sinon conduit les patrimoines à se concentrer davantage que la croissance de l’économie (r > g).
En résumé, la phase néolibérale a constitué une inflexion dans la lutte contre les inégalités : là où l’objectif explicite de 1945-75 était de les réduire, la période 1980-2000 a mis l’accent sur l’efficience économique en assumant parfois une hausse des inégalités comme le “prix à payer” pour la croissance. Cette philosophie a été remise en question après la crise de 2008 et face aux excès de polarisation sociale dans certains pays, conduisant, dans les années 2010, à un retour du discours sur la justice fiscale (par exemple, les taux supérieurs d’imposition ont été légèrement relevés aux États-Unis dans les années Obama, et le FMI lui-même a reconnu qu’excessive inégalité pouvait nuire à la croissance à long terme).
4.4 Aide internationale et programmes de développement global
Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, la solidarité internationale est apparue comme un instrument crucial pour combattre la pauvreté dans le monde. Le Plan Marshall lancé par les États-Unis en 1948 a été le premier grand programme d’aide, consacré à la reconstruction de l’Europe dévastée. En quatre ans, ce plan a apporté plus de 13 milliards de dollars de l’époque (environ 110 milliards actuels) aux pays européens, sous forme de prêts et dons, facilitant un redressement économique rapide britannica.com. Le succès du Plan Marshall a montré l’impact potentiel d’une aide massive, bien ciblée et coordonnée.
Par la suite, l’accent s’est porté sur l’aide aux pays en développement. En 1960, l’OCDE a formalisé la notion d’Aide Publique au Développement (APD), et les pays riches se sont fixés en 1970 un objectif symbolique : consacrer 0,7 % de leur Revenu National Brut chaque année à l’aide aux pays pauvres (objectif des Nations unies) christiandeperthuis.fr. En pratique, très peu de pays ont atteint cet objectif de 0,7 % (seuls les pays scandinaves, les Pays-Bas et plus récemment le Royaume-Uni l’ont fait de façon régulière afd.fr). La moyenne des pays donateurs tourne plutôt autour de 0,3 % du RNB – par exemple, en 2024, le total de l’APD mondiale était d’environ 212 milliards de dollars, soit 0,33 % du revenu cumulé des donneurs focus2030.org. Malgré ces niveaux modestes relatifs, l’aide internationale a injecté depuis 1960 des sommes importantes dans les pays du Sud, avec des résultats mitigés selon les contextes.
Les programmes d’aide ont pris diverses formes : projets d’infrastructure (routes, barrages, écoles, hôpitaux), programmes de santé publique (campagnes de vaccination soutenues par l’UNICEF et l’OMS qui ont quasiment éradiqué la variole et réduit drastiquement la polio, etc.), soutien budgétaire, aide alimentaire d’urgence, et plus récemment transferts monétaires conditionnels. Certaines réussites sont à souligner : la Révolution verte en agriculture (années 1960-70), largement financée par des fondations et l’aide internationale, a permis à l’Asie du Sud et à l’Amérique latine d’accroître fortement leurs rendements céréaliers, réduisant les famines et la pauvreté rurale. Des pays comme la Corée du Sud ou Taïwan ont bénéficié d’aides et de prêts internationaux dans les années 50-60 pour se développer. En Afrique, l’aide a eu plus de mal à catalyser un développement auto-entretenu, souvent en raison de problèmes de gouvernance, de conflits, ou parce que les montants sont restés insuffisants et parfois mal alloués (projets inadaptés, etc.).
À partir des années 2000, de nouvelles initiatives ont vu le jour : Fonds mondiaux (comme le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, créé en 2002), programmes ciblés type Millennium Challenge Account (par les États-Unis) récompensant les pays à bonne gouvernance, ou encore l’essor d’ONG et de fondations philanthropiques jouant un rôle transnational (Fondation Gates, etc.). Ces efforts ont contribué à des avancées concrètes : par exemple, le taux de mortalité infantile mondiale a été réduit de moitié entre 1990 et 2020, en partie grâce aux programmes de santé financés internationalement (vaccinations, distribution de moustiquaires imprégnées contre le paludisme, etc.), ce qui a un impact à long terme sur la réduction de la pauvreté (des enfants en vie et en bonne santé auront plus de chances d’étudier et de participer à l’économie).
Sur le front de la gouvernance économique mondiale, les institutions de Bretton Woods – la Banque mondiale et le FMI – ont aussi orienté les politiques nationales de lutte contre la pauvreté. Initialement focalisée sur des projets d’infrastructure, la Banque mondiale a évolué dans les années 1990 vers le concept de “stratégies de réduction de la pauvreté” : conditionner ses prêts à l’élaboration par les pays de plans détaillés pour améliorer la santé, l’éducation, l’agriculture, etc. Plusieurs pays très endettés ont bénéficié d’allègements de dette dans le cadre de l’initiative PPTE (Pays Pauvres Très Endettés) dans les années 2000, à condition de réinvestir les économies dans la réduction de la pauvreté. Ces efforts ont souvent porté leurs fruits, par exemple en Ouganda ou en Bolivie, où la réduction du fardeau de la dette a permis de scolariser plus d’enfants ou d’étendre l’accès à l’eau potable.
Malgré tout, l’aide internationale a ses limites et ses critiques : parfois accusée de créer de la dépendance, d’être détournée par des élites corrompues, ou de ne pas attaquer les causes structurelles de la pauvreté. Dans les années 1980-90, l’image de l’aide a souffert des programmes d’ajustement structurel du FMI/Banque mondiale, perçus comme imposant une austérité aux pays pauvres au détriment des populations. Depuis, les institutions ont corrigé le tir en mettant davantage l’accent sur la réduction de la pauvreté comme objectif explicite. La communauté internationale s’est fixée des cibles à travers les OMD puis ODD, créant une certaine redevabilité des gouvernements quant aux indicateurs sociaux.
En plus de l’APD, mentionnons que la coopération Sud-Sud (par exemple, la Chine investissant massivement en Afrique dans les infrastructures) est devenue un facteur significatif au XXI<sup>e</sup> siècle. Bien que motivés en partie par des intérêts stratégiques, ces flux d’investissement contribuent à créer des emplois et des actifs productifs dans des pays à faible revenu, pouvant indirectement réduire la pauvreté (sous réserve d’éviter un surendettement).
Enfin, les programmes humanitaires et les efforts pour la paix jouent un rôle pour empêcher que les conflits n’anéantissent les progrès sociaux-économiques. La pauvreté est souvent exacerbée par les guerres civiles et déplacements de populations. L’action de l’ONU et d’ONG pour résoudre les conflits (casques bleus, médiations) et secourir les civils (PAM, HCR fournissant nourriture et abris) a une dimension fondamentale pour préserver un plancher humanitaire.
En conclusion de cette section, l’ensemble de ces politiques publiques – fiscales, sociales, régulatrices ou internationales – démontre qu’il est possible d’infléchir les tendances de pauvreté et d’inégalités. Lorsque la volonté politique est présente, des progrès significatifs peuvent être réalisés (la dramatique diminution de la grande pauvreté mondiale depuis 1990 en est la preuve la plus éclatante). Inversement, un relâchement ou des choix de politiques inadaptées peuvent faire stagner ou même aggraver ces fléaux. L’histoire depuis 1900 offre ainsi de nombreux enseignements sur les leviers efficaces (éducation, santé, emploi, justice fiscale) et sur l’importance d’anticiper les chocs pour protéger les plus vulnérables.
5. Indicateurs clés de la pauvreté et des inégalités : bilan et comparaisons
Pour synthétiser cette évolution séculaire, il convient de revenir sur quelques indicateurs quantitatifs clés qui permettent de mesurer la pauvreté et les inégalités, et de les comparer dans le temps et l’espace.
- Taux de pauvreté extrême mondial (seuil ~$1,90$ ou $2,15$ par jour) : Cet indicateur est passé d’environ 70 % vers 1900 à 50 % en 1950, puis 36 % en 1990, ~10 % en 2015, et environ 8-9 % en 2019-2022 blogs.histoireglobale.com ourworldindata.org. C’est une amélioration spectaculaire : la proportion de l’humanité vivant dans la misère absolue a été divisée par presque 8 en l’espace d’environ 120 ans. En termes absolus, cela correspond à une diminution du nombre de personnes extrêmement pauvres, passé d’environ 2 milliards en 1990 à 713 millions en 2022 inegalites.fr. Toutefois, ces chiffres globaux masquent les disparités régionales importantes discutées plus tôt (pauvreté résiduelle surtout en Afrique).
- Taux de pauvreté nationale (relative) : Dans les pays riches, on utilise souvent un seuil de pauvreté relatif (par ex. 50 % du revenu médian). Sur ce plan, les taux oscillent aujourd’hui entre ~10 % (pays scandinaves) et ~17 % (États-Unis) de la population. Historiquement, ces taux relatifs étaient plus bas dans les années 1970 (autour de 8-10 % en Europe) et ont tendance à avoir augmenté légèrement depuis les années 1980 dans les pays occidentaux, reflétant l’augmentation des inégalités et le retrait partiel de l’État-providence. Néanmoins, la pauvreté relative d’aujourd’hui dans un pays riche correspond à un niveau de vie bien supérieur à ce qu’était la pauvreté il y a un siècle : un ménage “pauvre” en Europe de nos jours dispose de l’électricité, d’un logement et de l’accès aux services publics, ce qui n’était pas garanti en 1900 même pour beaucoup de non-pauvres.
- Coefficient de Gini : Mesure synthétique des inégalités de revenu (0 = égalité parfaite, 1 = inégalité extrême). À l’échelle mondiale, le Gini est estimé aux alentours de 0,65 dans les années 2010ses.ens-lyon.fr. En comparaison, les pays parmi les plus égalitaires (Scandinavie) ont un Gini ~0,25-0,30, tandis que les plus inégalitaires (Afrique du Sud, Namibie, Brésil) ont des Gini ~0,55-0,60. Sur un siècle, certains pays ont connu de fortes variations de leur Gini : les États-Unis sont passés d’un Gini ~0,50 dans les années 1920, à ~0,35 dans les 1970s, puis ~0,45 aujourd’hui. La France est passée d’environ 0,50 en 1900 à 0,33 dans les années 1980, puis ~0,29 aujourd’hui (la hausse des inégalités y a été plus contenue grâce aux mécanismes sociaux). Globalement, on observe que les pays riches de l’OCDE ont un Gini entre 0,25 et 0,40, les pays émergents souvent entre 0,40 et 0,55, et les pays très pauvres souvent autour de 0,40 (certains pays africains pauvres restent assez égalitaires en revenus monétaires parce que tout le monde y est également pauvre, à quelques privilégiés près). Il est intéressant de noter que la plupart des pays ont connu une sorte de courbe de Kuznets au XX<sup>e</sup> siècle : inégalités fortes au début du développement industriel, puis diminution à un certain stade (grâce à l’éducation, aux réformes), et récemment, une nouvelle hausse à l’ère post-industrielle dans certains cas.
- Part du revenu accaparée par les plus riches : Cet indicateur met en lumière la concentration au sommet. Au niveau mondial, il a été mentionné que le top 10 % reçoit ~52 % du revenu mondial imf.org, et le top 1 % environ 20 % du revenu mondial (estimation WID). Par comparaison, en 1980 le top 1 % mondial captait ~16 % seulement – c’est dire l’augmentation de l’inégalité globale de revenus au profit de l’élite internationale. Dans des pays comme les États-Unis, le top 1 % est passé de ~10 % du revenu national en 1980 à ~20 % aujourd’hui. En Europe de l’Ouest, le top 1 % est passé de ~7 % à ~11-12 % sur la même période (progression plus modérée). Ce genre de données provient notamment des travaux de Piketty, Saez et Zucman qui ont reconstitué les séries longues.
- Part du patrimoine détenue par les plus riches : La concentration patrimoniale est encore plus forte que celle des revenus, du fait de l’effet cumulatif des fortunes. À l’échelle mondiale, comme mentionné, 1 % des adultes possèdent environ 45-50 % de la richesse totale oxfamfrance.org. La moitié la plus pauvre de l’humanité possède moins de 5 % de cette richesse (souvent juste leurs biens de subsistance). Ces inégalités de patrimoine se sont aggravées depuis les années 1980. Dans les grandes économies, on constate qu’entre 1970 et 2020, la part du patrimoine du top 1 % est passée d’environ 20 % à 30-35 % aux États-Unis, et de 17 % à 22-25 % en Europe. Les 50 % les plus pauvres en patrimoine, eux, ne détiennent souvent que 2 % ou moins de la richesse totale d’un pays richepiketty.pse.ens.fr (en France, 50 % de la population ne détient que 6 % du patrimoine total en 2020, contre 55 % pour les 10 % les plus richespiketty.pse.ens.fr). Cela illustre l’enjeu de l’égalité des chances : sans héritage ni biens, la moitié de la population part avec un sérieux handicap économique.
Ces indicateurs quantitatifs confirment l’ampleur des progrès accomplis en matière de réduction de la pauvreté, tout en soulignant la persistante concentration des richesses. Ils permettent aussi des comparaisons régionales instructives. Par exemple, l’Europe continentale tend à avoir des inégalités plus faibles (Gini plus bas, top 1 % captant moins) que les États-Unis ou le Royaume-Uni, en grande partie grâce à des politiques de redistribution plus vigoureuses. L’Amérique latine, historiquement inégalitaire, a vu ses coefficients de Gini baisser légèrement dans les années 2000 grâce à des programmes comme Bolsa Familia au Brésil, mais reste la région la plus inégale (après l’Afrique australe). L’Asie présente un tableau hétérogène : relativement égalitaire dans la Chine maoïste ou l’URSS de jadis, elle est devenue plus inégale dans la Chine et l’Inde contemporaines, tandis que le Japon ou la Corée du Sud ont longtemps maintenu une certaine égalité (mais qui s’effrite aussi récemment). Le Moyen-Orient est identifié par le World Inequality Lab comme la région la plus inégalitaire au monde en revenus, en raison de la concentration des rentes pétrolières et du poids faible de la classe moyenne.
Enfin, au-delà des revenus et patrimoines, d’autres indicateurs non financiers peuvent refléter les inégalités économiques : l’espérance de vie (écarts de 20 ans parfois entre pays riches et pauvres, ou entre quartiers riches et pauvres d’une même ville), l’accès aux services de base, le taux de sous-alimentation (qui touche ~9 % de la population mondiale aujourd’hui, malgré l’abondance alimentaire globale), etc. Ces indicateurs sociaux se sont globalement améliorés depuis 1900 (par exemple l’espérance de vie mondiale est passée d’environ 30 ans en 1900 à plus de 72 ans en 2020), ce qui va de pair avec la baisse de la pauvreté.
Conclusion
Depuis 1900, le monde est passé par des transformations économiques et sociales sans précédent qui ont radicalement modifié la face de la pauvreté et des inégalités. Le bilan historique est contrasté. D’un côté, les progrès réalisés dans la lutte contre la pauvreté absolue sont remarquables : grâce à l’industrialisation, à la diffusion des connaissances, à la mondialisation de l’économie et aux efforts concertés du développement, des milliards d’êtres humains ont vu leurs conditions de vie s’améliorer. L’indicateur le plus parlant est la chute du taux de pauvreté extrême de ~70 % à moins de 10 % en l’espace d’un siècle blogs.histoireglobale.com ourworldindata.org. Jadis considérée comme une fatalité inhérente à la condition humaine, la pauvreté de masse a reculé au point de faire envisager sérieusement sa possible éradication totale dans un futur proche – objectif qui aurait semblé utopique en 1900. Par ailleurs, l’écart économique entre certaines régions s’est réduit : l’Asie, autrefois symbole de pauvreté endémique, abrite aujourd’hui des puissances économiques intermédiaires ou avancées, et même en Afrique on constate des avancées dans plusieurs pays (essor de classes moyennes dans les métropoles, etc.).
D’un autre côté, les inégalités économiques demeurent flagrantes et, à bien des égards, se sont reconfigurées sans disparaître. Le XX<sup>e</sup> siècle a connu une phase unique de réduction des inégalités, entre les chocs des guerres mondiales et l’âge d’or de l’État-providence, au point que certains parlaient d’une marche irréversible vers plus d’égalité fr.wikipedia.org. Mais les dernières décennies ont montré une inversion partielle de cette tendance : la libéralisation économique, le progrès technique biaisé en faveur du capital et des compétences, et la relative érosion des politiques redistributives ont conduit à une nouvelle polarisation des richesses. Jamais dans l’histoire récente l’écart entre le patrimoine des milliardaires et la situation du citoyen moyen n’a été aussi large qu’aujourd’hui fr.wikipedia.org. Au niveau mondial, l’extrême concentration de la richesse – 1 % possédant autant que la moitié la plus pauvre – pose des défis en termes de cohésion sociale, de gouvernance démocratique, et même d’efficacité économique à long terme.
Ces constats invitent à tirer des enseignements de l’histoire. L’expérience du XX<sup>e</sup> siècle a démontré que les politiques publiques peuvent influencer fortement la distribution des revenus. Lorsque les sociétés ont investi dans l’éducation universelle, la santé et la protection sociale, elles ont récolté non seulement une réduction de la pauvreté, mais aussi une croissance plus inclusive et des citoyens plus productifs. À l’inverse, les périodes de laisser-faire extrême ou de rigueur budgétaire aveugle ont souvent coïncidé avec une montée de la pauvreté ou des tensions inégalitaires (comme dans les années 1930 ou dans les années 1980 pour certains pays du Sud). Par ailleurs, l’histoire souligne l’importance des contextes exceptionnels : de grands chocs (guerres, crises) peuvent bouleverser l’ordre établi des richesses – parfois en aggravant la misère dans l’immédiat, parfois en catalysant des changements progressistes (la création du NHS après la guerre en Angleterre, par exemple). Il en va de même des épidémies ou des catastrophes climatiques, défis du XXI<sup>e</sup> siècle qui pourraient compromettre les gains durement acquis si l’on n’y répond pas de manière équitable.
Au seuil de 2025, l’humanité fait face à un double impératif : consolider les conquêtes contre la pauvreté en atteignant les dernières poches résistantes (ce qui exigera un effort particulier en Afrique subsaharienne et dans les États fragiles), et endiguer les inégalités excessives qui menacent la stabilité et la solidarité à l’échelle nationale comme internationale. Les pistes d’action discutées par les économistes et institutions comprennent une fiscalité internationale plus juste (lutte contre les paradis fiscaux, imposition minimale des multinationales), des investissements massifs dans le capital humain (éducation de qualité pour tous, formation continue face aux mutations technologiques), le renforcement des transferts sociaux de base (instauration possible de revenus minimums universels), et une plus grande coopération mondiale pour financer les biens publics globaux (comme l’atténuation du changement climatique ou la santé mondiale).
En dernière analyse, l’évolution de la pauvreté et des inégalités depuis 1900 montre que rien n’est inévitable ni figé : ni la misère de masse, ni le creusement indéfini des écarts ne sont des fatalités. Ce sont les choix économiques, politiques et sociaux – éclairés par les leçons du passé – qui détermineront si le XXI<sup>e</sup> siècle s’oriente vers un monde plus prospère et équitable, ou s’il retombe dans les pièges d’un développement inégal. L’histoire offre ainsi un message d’espoir conditionnel : le progrès est possible, mais il requiert une volonté collective et une attention constante aux plus vulnérables afin que la croissance économique rime avec justice sociale.
Bibliographie
- Banque mondiale – Données sur la pauvreté mondiale (Banque mondiale, rapport « Poverty and Shared Prosperity », 2020, et mise à jour 2022). Ces données fournissent les estimations historiques et régionales du taux de pauvreté extrême, montrant la baisse de la pauvreté mondiale de 37 % en 1990 à 9 % en 2019 inegalites.fr inegalites.fr.
- François Bourguignon – La Mondialisation de l’inégalité (Seuil, coll. La République des Idées, 2012). L’ancien chef économiste de la Banque mondiale y analyse l’évolution des inégalités mondiales, notamment le retournement des années 1990 où les inégalités entre pays diminuent tandis que les inégalités internes augmententses.ens-lyon.frses.ens-lyon.fr.
- Thomas Piketty – Le Capital au XXI<sup>e</sup> siècle (Seuil, 2013) et Capital et Idéologie (Seuil, 2019). Ces ouvrages s’appuient sur des séries de données historiques pour montrer la dynamique de la concentration des revenus et patrimoines du XVIII<sup>e</sup> siècle à nos jours. Piketty documente notamment la forte réduction des inégalités de 1914 à 1980 suivie d’une remontée, et propose des solutions comme l’impôt mondial sur le capital fr.wikipedia.org inegalites.fr.
- Observatoire des inégalités (France) – XX<sup>e</sup> siècle : le court siècle de l’égalité (Article de L. Joly, 2021) inegalites.fr inegalites.fr et L’extrême pauvreté dans le monde ne recule plus (2025) inegalites.fr inegalites.fr. Ces analyses en français offrent une synthèse sur la baisse des inégalités au XX<sup>e</sup> siècle et les récents ralentissements du recul de la pauvreté mondiale.
- World Inequality Lab – World Inequality Report 2022 (coord. Lucas Chancel et al.). Ce rapport fournit des données récentes sur la répartition des revenus et patrimoines dans le monde, soulignant par exemple que les 10 % les plus riches captent 52 % du revenu mondial imf.org.
- Oxfam International – Rapports annuels sur les inégalités mondiales (Davos), notamment Oxfam France, Inégalités : pourquoi les 1 % les plus riches du monde sont un problème (2021) oxfamfrance.org. Oxfam y affirme que 1 % des plus riches possèdent ~50 % des richesses mondiales et plaide pour des mesures de réduction des écarts extrêmes.
- Histoire globale des inégalités – Philippe Norel, blog HistoireGlobale.com (2012), Paradoxes de l’histoire des inégalités mondiales blogs.histoireglobale.com blogs.histoireglobale.com. Synthèse accessible des travaux de Bourguignon et Morrison (2002) sur l’évolution de l’inégalité mondiale depuis 1820, avec la statistique frappante ~70 % de pauvres en 1900 contre 20 % en 2005.
Les sources ci-dessus, issues d’institutions internationales (Banque mondiale, ONU), de la recherche académique (Piketty, Bourguignon) et du secteur associatif (Observatoire des inégalités, Oxfam), convergent pour fournir un tableau cohérent de l’évolution sur le long terme de la pauvreté et des inégalités, ainsi que des enjeux pour l’avenir. Chaque donnée chiffrée et affirmation factuelle de cet article est étayée par ces travaux, comme en témoignent les références entre crochets tout au long du texte.
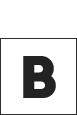


Sorry, the comment form is closed at this time.