23 Fév L’évolution de la consommation d’énergie dans le monde
Une demande mondiale en forte croissance depuis 1950
La consommation énergétique mondiale a augmenté de manière spectaculaire depuis le milieu du XXe siècle. Elle a été multipliée par environ huit entre 1950 et aujourd’hui ourworldindata.org. En 1950, le monde consommait de l’ordre de quelques milliers de Mtep d’énergie primaire ; en 2023, la demande annuelle dépasse 620 exajoules (soit environ 14 800 Mtep, ou 172 000 TWh) fr.wikipedia.org. Cette hausse reflète la croissance démographique et économique : la population mondiale s’est fortement accrue et de nombreux pays se sont industrialisés, entraînant une explosion des besoins énergétiques. Par exemple, entre 1990 et 2019, la consommation mondiale est passée de 357 à 589 EJ (+65 %) connaissancedesenergies.org. Chaque décennie jusqu’en 2020 a vu une progression de la demande, hormis un ralentissement ponctuel en 2020 (pandémie de Covid-19) vite compensé par un rebond en 2021 bp.com.
En dépit des améliorations d’efficacité énergétique, la consommation par habitant a continué de croître légèrement, de sorte que la demande mondiale d’énergie augmente un peu plus vite que la population depuis 1990 fr.wikipedia.org. Globalement, l’humanité n’a jamais autant consommé d’énergie qu’aujourd’hui. Cette trajectoire reste portée par le développement économique, l’urbanisation et l’accès accru à l’électricité dans de nombreuses régions du globe. La dépendance aux combustibles fossiles instaurée avec la révolution industrielle a perduré : ces sources d’énergie dominent toujours le bilan énergétique planétaire malgré l’essor récent des alternatives.
Évolution par source d’énergie primaire
Énergies fossiles : charbon, pétrole et gaz naturel
Les combustibles fossiles (charbon, pétrole, gaz) constituent la base du mix énergétique moderne et dominent depuis la révolution industrielle ourworldindata.org iea.org. Dans les années 1950, le charbon était encore la première source d’énergie mondiale, utilisé massivement dans l’industrie et la production d’électricité. Cependant, la seconde moitié du XXe siècle a vu le règne du pétrole : la demande de pétrole a explosé après la Seconde Guerre mondiale, pour en faire la source d’énergie la plus consommée à partir des années 1960-1970. Le gaz naturel, de son côté, a pris son essor plus tard avec le développement des gazoducs et a connu une croissance soutenue à partir des années 1970.
Aujourd’hui, les fossiles fournissent toujours environ 80 % de l’énergie primaire mondiale iea.org. Le pétrole reste la première source individuelle, représentant 30,2 % de l’énergie primaire en 2022 fr.wikipedia.org. Sa part a légèrement diminué par rapport à 1990 (37,2 %) en raison de la diversification du mix fr.wikipedia.org, mais la consommation de pétrole a tout de même fortement augmenté en volume (+~40 % sur les vingt dernières années). En 2022, environ 27,6 % de l’énergie mondiale était fournie par le charbon fr.wikipedia.org. Après un déclin relatif dans les années 1990, l’usage du charbon a rebondi avec l’industrialisation rapide de l’Asie : la consommation de charbon a notamment triplé en Chine entre 1990 et 2023 fr.wikipedia.org. Globalement, la part du charbon est passée de 25,5 % en 1990 à 27,6 % en 2022 fr.wikipedia.org – une hausse modeste en pourcentage, mais sa consommation absolue a connu un pic au milieu des années 2010 (soutenu par la Chine et l’Inde) avant une stabilisation récente. Le gaz naturel, enfin, est la source fossile ayant connu la progression la plus rapide sur la période récente. Sa part est passée d’environ 20 % en 1990 à 23,1 % en 2022 fr.wikipedia.org. En volume, la consommation de gaz a crû d’environ un tiers depuis 2000, reflétant son déploiement comme source d’électricité et de chauffage moins carbonée que le charbon. Cette évolution vers davantage de gaz s’observe particulièrement en Europe et en Asie.
Malgré des variations internes (transition du charbon vers le pétrole puis le gaz), l’ensemble énergies fossiles a conservé une prédominance durable. En 1970, elles représentaient plus de 90 % de l’approvisionnement énergétique mondial, et encore 81,8 % en 2022 connaissancedesenergies.org. Les efforts pour réduire cette dépendance commencent à peine à infléchir la tendance. On constate certes un recul progressif de la part du pétrole et une stabilisation du charbon dans le mix récent, mais le trio pétrole-gaz-charbon n’en continue pas moins d’alimenter l’essentiel de la croissance énergétique mondiale au début du XXIe siècle.
L’énergie nucléaire
Introduite commercialement dans les années 1950, l’énergie nucléaire s’est rapidement développée dans les décennies suivantes. La production mondiale d’électricité d’origine nucléaire est passée de seulement 25 TWh en 1965 à près de 1 945 TWh en 1989, grâce aux nombreux réacteurs construits en Europe, en Amérique du Nord et en Asie connaissancedesenergies.org. La part du nucléaire dans l’énergie primaire mondiale a atteint un pic d’environ 6 à 7 % vers la fin des années 1990 (6,64 % en 2000) connaissancedesenergies.org. Depuis, son poids relatif a décliné à 4 % environ en 2022 connaissancedesenergies.org. Cette baisse s’explique par la croissance plus rapide des autres sources et par un rythme de nouvelles constructions plus lent après les années 1990 (lié notamment aux accidents de Three Mile Island en 1979, Tchernobyl en 1986 et Fukushima en 2011).
En termes de volume, la production nucléaire mondiale a stagné ces deux dernières décennies. Après avoir plafonné au début des années 2000, elle a retrouvé en 2021 son niveau record d’avant Fukushima (environ 2 762 TWh) connaissancedesenergies.org. En 2023, elle atteignait 2 686 TWh connaissancedesenergies.org, soit un niveau quasi équivalent à celui de 2006. Plusieurs pays développés ont ralenti ou arrêté leurs programmes nucléaires (ex. Allemagne, Japon), tandis que d’autres (Chine, Russie, Inde) poursuivent de nouvelles constructions. Le nucléaire contribue aujourd’hui à environ 10 % de la production d’électricité mondiale fr.wikipedia.org, mais seulement ~4 % de l’énergie primaire totale. Son rôle futur dépendra des choix politiques : certains y voient un atout bas-carbone à consolider, d’autres privilégient le développement des renouvelables et l’efficacité énergétique.
Les énergies renouvelables : hydraulique, éolien, solaire, biomasse
Les sources d’énergie renouvelables regroupent l’hydroélectricité, la biomasse (bois, déchets organiques, biocarburants), l’énergie éolienne, solaire, géothermique, etc. En 1950, la principale énergie renouvelable utilisée était la biomasse traditionnelle (bois de chauffe, résidus agricoles), particulièrement dominante dans les zones rurales des pays en développement. Au milieu du XXe siècle, cette biomasse représentait encore une part significative de la consommation énergétique dans de nombreuses régions. Cependant, son importance relative a diminué à mesure que les combustibles fossiles prenaient le relais pour les usages modernes (transport, électricité, industrie). L’autre renouvelable historique est l’hydroélectricité : dès les années 1950-1970, de grands barrages hydroélectriques ont été édifiés (États-Unis, Europe, puis Amérique latine, Asie) fournissant une électricité abondante et bon marché dans certains pays.
Depuis le début du XXIe siècle, on assiste à une expansion accélérée des énergies renouvelables modernes. La part des renouvelables dans le mix énergétique mondial, qui n’était que 6,3 % en 1970, a plus que doublé pour atteindre 14,2 % en 2022 connaissancedesenergies.org connaissancedesenergies.org. Cette croissance est portée par les progrès technologiques, la baisse des coûts et les politiques climatiques incitatives. L’hydraulique reste la première source renouvelable d’électricité : en 2022, elle contribue environ 6,4 % de l’énergie primaire mondiale fr.wikipedia.org et près de 15 % de la production électrique en.wikipedia.org. La production hydroélectrique a crû régulièrement (grands barrages en Chine, Brésil, Afrique…), avec une augmentation d’environ +60 % de 2000 à 2020.
Les énergies éolienne et solaire connaissent, quant à elles, une progression exponentielle. Quasi inexistantes en 2000, elles représentent en 2023 environ 8 % de l’électricité mondiale en.wikipedia.org. L’éolien fournit désormais plus de 2 500 TWh par an, et le solaire plus de 2 100 TWh en.wikipedia.org – des niveaux atteints après des doublesments successifs de capacité chaque décennie. En deux décennies, l’éolien a vu sa production multipliée par plus de 50, et le solaire photovoltaïque par plus de 100. Même si leur part dans l’énergie primaire totale reste modeste (~1-2 % chacun), ces deux filières contribuent de plus en plus au mix électrique et enregistrent les plus fortes croissances de tous les secteurs énergétiques. Enfin, la biomasse moderne (biocarburants, biomasse énergétique industrielle) s’est développée (éthanol, biodiesel, centrales biomasse), mais la consommation traditionnelle de bois stagne ou recule dans certaines régions grâce à l’accès à des combustibles modernes. Au total, la biomasse et les déchets comptent encore pour une part non négligeable du mix (on l’estime à environ 7-8 % de l’énergie primaire en 2022), bien que leur part relative ait baissé depuis 1990 du fait de l’essor des autres renouvelables fr.wikipedia.org.
En somme, les énergies renouvelables ont entamé une percée notable dans le système énergétique mondial. Leurs coûts en baisse et les préoccupations environnementales ont conduit à une multiplication des investissements dans l’éolien et le solaire, qui sont devenus en quelques années des composantes majeures de l’expansion électrique. La transition est toutefois graduelle : en 2022, les renouvelables (y compris hydro et biomasse) fournissent environ 16 % de la consommation finale d’énergie fr.wikipedia.org – un chiffre en hausse lente, car la forte progression des nouvelles EnR compense tout juste le recul de la biomasse traditionnelle fr.wikipedia.org.
Tableau : Comparatif des sources d’énergie (parts, croissance et émissions)
| Source d’énergie | Part du mix (2022) | Croissance (2002–2022) | Émissions CO₂ associées (annuelles) |
|---|---|---|---|
| Charbon | 27,6 % fr.wikipedia.org | + ~15 % | ~15,5 Gt CO₂ (2022) iea.org |
| Pétrole | 30,2 % fr.wikipedia.org | + ~40 % | ~11,4 Gt CO₂ (2022) fr.wikipedia.org |
| Gaz naturel | 23,1 % fr.wikipedia.org | + ~35 % | ~7–8 Gt CO₂ (2022, estimé) |
| Nucléaire | ~4 % connaissancedesenergies.org | ~ stable | ~0 (0,006 kgCO₂/kWh) climate.selectra.com |
| Hydroélectricité | ~6,4 % fr.wikipedia.org | + ~50 % | ~0 (0,006 kgCO₂/kWh) climate.selectra.com |
| Éolien | ~1–2 % (énergie primaire) | + >2000 % | ~0 (très faibles) |
| Solaire | ~1 % (énergie primaire) | + >5000 % | ~0 (très faibles) |
| Biomasse | ~8 % (incl. déchets) | + ~20 % | Combustion neutre en CO₂ * |
* Note : la biomasse émet du CO₂ lors de sa combustion, mais il s’agit de carbone recyclé de l’atmosphère par la croissance des plantes ; son **bilan net** peut donc être neutre si la ressource est gérée durablement (replantation, etc.).
Différences régionales marquantes
L’évolution de la consommation d’énergie n’est pas homogène selon les régions du monde. Au cours des dernières décennies, on observe un déplacement du centre de gravité énergétique vers les pays émergents. En 1970, la majeure partie de l’énergie était consommée par les économies industrialisées d’Amérique du Nord, d’Europe et d’ex-URSS. Depuis, la croissance de la demande provient surtout de l’Asie, du Moyen-Orient et, dans une moindre mesure, de l’Amérique latine et de l’Afrique.
La consommation énergétique des pays en développement a explosé avec l’industrialisation et l’urbanisation. Par exemple, la région Asie-Pacifique est passée de 16 % de la consommation mondiale en 1973 à 45 % en 2019 encyclopedie-energie.org. La Chine à elle seule représente aujourd’hui 22,8 % de … la consommation mondiale en 2022, devant les États-Unis (15,7 %), l’Inde (6,7 %) et la Russie (5,3 % fr.wikipedia.org. À eux quatre, ces pays concentraient plus de la moitié de la consommation énergétique planétaire en 202 fr.wikipedia.org. La croissance récente est surtout tirée par l’Asie : entre 1990 et 2019, la consommation de l’Asie a quasiment triplé, passant de 107 EJ à 299 EJ par a connaissancedesenergies.org, reflétant l’essor industriel de la Chine et de l’Inde. En revanche, dans les économies matures (Europe, Amérique du Nord, Japon), la demande d’énergie a progressé beaucoup plus lentement et tend à se stabiliser voire baisser légèrement depuis les années 2010. Par exemple, la consommation de l’Europe ne représentait que 17 % du total mondial en 2019 (107 EJ connaissancedesenergies.org, en déclin relatif sur longue période.
On note d’importantes disparités de consommation par habitant : un Nord-Américain moyen consomme plusieurs fois plus d’énergie qu’un Africain. Les plus gros consommateurs d’énergie par tête utilisent plus de dix fois l’énergie des plus petits consommateur ourworldindata.org. Cette inégalité reflète le niveau de vie, l’accès aux technologies et l’efficacité énergétique des différentes économies. Globalement, les pays développés ont déjà un usage énergétique élevé et optimisé, tandis que de nombreux pays émergents voient leur consommation par habitant augmenter avec l’amélioration des infrastructures et du pouvoir d’achat.
Les facteurs d’évolution de la consommation
Plusieurs facteurs clés expliquent l’évolution de la demande d’énergie depuis 1950 :
- La croissance démographique et économique : L’augmentation de la population mondiale (passée d’environ 2,5 à 8 milliards d’habitants de 1950 à 2025) et l’essor économique (PIB mondial multiplié par plus de 10 sur la même période) ont mécaniquement accru les besoins en énergie. L’industrialisation rapide de pays comme la Chine, l’Inde ou les « Tigres » d’Asie du Sud-Est a été particulièrement énergivore, tout comme auparavant celle de l’Europe de l’Est ou du Moyen-Orien encyclopedie-energie.org. L’urbanisation et le développement des transports motorisés ont également intensifié la demande.
- Le niveau de vie et la modernisation des usages : L’accès universel à l’électricité, la généralisation de l’électroménager, de la climatisation ou encore de l’informatique ont augmenté la consommation dans les ménages. De même, l’essor de la mobilité (automobile, avion) a fait bondir la demande de carburants. Dans les pays émergents, le passage de modes de vie ruraux (basés sur la biomasse traditionnelle) à des modes de vie urbains connectés au réseau et aux carburants fossiles a provoqué une transition énergétique interne qui accroît temporairement la consommation par habitant.
- Les innovations technologiques et la disponibilité des ressources : Le développement de nouvelles techniques d’extraction et de conversion a ouvert l’accès à plus d’énergie. Par exemple, l’exploitation des gisements offshore et le forage horizontal ont permis d’accroître la production de pétrole et de gaz. Plus récemment, la fracturation hydraulique a révolutionné la production de gaz (et pétrole) de schiste en Amérique du Nord, rendant le gaz abondant et bon marché. De même, les progrès en ingénierie ont abaissé les coûts de l’éolien et du solaire, favorisant leur déploiement. Chaque nouvelle source disponible (nucléaire dans les années 1970, renouvelables dans les années 2000) est venue s’ajouter aux précédentes plutôt que s’y substituer entièrement, alimentant la croissance globale de l’offre d’énergie.
- Les chocs géopolitiques et les politiques publiques : Des événements comme les chocs pétroliers de 1973 et 1979 ont temporairement freiné la consommation en Occident en incitant aux économies d’énergie et en déclenchant des politiques d’efficacité énergétique (limitation de vitesse, isolation des bâtiments, etc.). Inversement, la période de pétrole bon marché des années 1990 a encouragé un usage intensif des carburants. Depuis les années 2000, les préoccupations climatiques et les politiques associées (taxes carbone, subventions aux renouvelables, normes d’efficacité) influencent de plus en plus la trajectoire énergétique. Par exemple, l’Union européenne s’est fixée des objectifs contraignants sur les énergies renouvelables et l’efficacité, infléchissant sa demande énergétique. Globalement, on observe un début de découplage entre croissance économique et consommation d’énergie dans certains pays avancés, grâce aux gains d’efficacité : sur la décennie 2010, la consommation mondiale augmentait en moyenne de +1,5 %/an, moins vite que le PIB mondia iea.org.
- Les choix du mix énergétique et l’accès aux ressources : Certains pays ont misé sur des ressources locales abondantes – par exemple le charbon en Chine ou en Inde pour soutenir leur industrialisation, ou le gaz naturel au Moyen-Orient. D’autres, dépourvus de ressources fossiles, ont développé le nucléaire (France) ou l’hydroélectricité (Brésil, Canada, Norvège). Ces orientations stratégiques ont modulé l’évolution de la consommation par source d’énergie. Par ailleurs, l’accès à l’énergie moderne s’est fortement amélioré dans les pays du Sud : l’ONU estime que 75 millions de personnes pourraient retomber dans la précarité énergétique en 2022 du fait de la crise des prix, mais cela fait suite à des décennies de progrès où plus d’un milliard de personnes ont obtenu l’accès à l’électricit iea.org iea.org.
Enjeux environnementaux et transition énergétique
L’essor massif de la consommation d’énergie s’est accompagné de conséquences environnementales majeures. En premier lieu, la combustion du charbon, du pétrole et du gaz émet des gaz à effet de serre, principalement du dioxyde de carbone (CO₂), responsable du changement climatiqu fr.wikipedia.org. Les émissions mondiales de CO₂ liées à l’énergie ont ainsi grimpé de ~6 milliards de tonnes en 1950 à plus de *36 milliards de tonnes en 2021 weforum.org weforum.org, atteignant un record de *36,8 Gt CO₂ en 2022 iea.org. Cela représente une augmentation de près de 90 % depuis 197 climate.selectra.com. La consommation de charbon est particulièrement polluante : ce combustible reste le plus émetteur de CO₂ par kWh d’énergie produite (environ 1,06 kg CO₂ par kWh climate.selectra.com. En 2022, les centrales à charbon du monde ont rejeté près de 15,5 Gt de CO₂, soit environ 42 % des émissions énergétique iea.org. Le pétrole a engendré environ 11,4 Gt CO₂ (33 % du total) la même anné fr.wikipedia.org, et le gaz naturel autour de 7 à 8 Gt (environ 20 %). Cet usage intensif des combustibles fossiles fait du secteur de l’énergie le principal contributeur au réchauffement climatique actue climate.selectra.com.
Au-delà du climat, les énergies fossiles posent d’autres problèmes environnementaux. Leur extraction et leur transport entraînent des marées noires, des pollutions des sols et des eaux (extractions de sable bitumineux, fuites de gaz, déforestation pour le charbon, etc.), tandis que leur combustion dégage des polluants atmosphériques nocifs pour la santé (particules fines, oxydes d’azote, soufre…). On estime que la pollution de l’air liée aux combustibles fossiles cause des millions de décès prématurés chaque année dans le mond ourworldindata.org. Les impacts locaux (pluies acides, smog urbain, mercure issu des centrales à charbon) et globaux (dérèglement du climat, acidification des océans) ont conduit à une prise de conscience de l’impératif de changer de modèle énergétique.
Ainsi, depuis une vingtaine d’années, les politiques climatiques et la transition énergétique occupent une place centrale dans les agendas internationaux. L’Accord de Paris de 2015 engage la communauté mondiale à limiter le réchauffement « nettement en dessous de 2 °C », ce qui implique de réduire drastiquement les émissions de CO₂ dans les prochaines décennies. Concrètement, cela nécessite une transformation profonde du système énergétique : amélioration de l’efficacité (faire plus avec moins d’énergie), électrification des usages (transport électrique, pompes à chaleur) et surtout substitution des énergies fossiles par des sources bas-carbone. Les énergies renouvelables (solaire, éolien, hydro, biomasse durable) et le nucléaire font partie des solutions pour décarboner la production d’électricité et de chaleur. Parallèlement, des technologies comme le captage et stockage du carbone (CSC) ou l’hydrogène vert sont explorées pour réduire l’empreinte carbone des secteurs difficiles à électrifier.
Les efforts mondiaux de transition commencent à se refléter dans les investissements : en 2023-2024, les capitaux engagés dans les énergies renouvelables et propres dépassent de plus du double ceux consacrés aux énergies fossile connaissancedesenergies.org. De nombreux pays ont adopté des objectifs de neutralité carbone à l’horizon 2050–2060, et mettent en place des plans pour fermer les centrales au charbon les plus anciennes, déployer massivement éoliennes et panneaux solaires, et promouvoir les véhicules électriques. Ces actions contribuent déjà à infléchir légèrement la trajectoire d’émissions : en 2022, malgré un rebond de l’usage du charbon, la hausse des émissions de CO₂ (+0,9 %) est restée inférieure à la croissance économique, grâce à l’essor des énergies propres qui a évité environ 550 Mt de CO₂ supplémentair iea.org iea.org.
Néanmoins, les défis restent immenses. La part des combustibles fossiles dans le mix mondial demeure obstinément élevée (autour de 80 % iea.org et les émissions de CO₂ atteignent des niveaux records. Selon les projections de l’Agence internationale de l’énergie, avec les politiques actuelles, les énergies fossiles pourraient encore représenter ~60 % de l’approvisionnement en 2050, et les émissions annuelles ne redescendraient qu’à ~32 Gt à cet horizo iea.org – un scénario insuffisant pour contenir le réchauffement climatique. Pour parvenir aux objectifs climatiques, il faudrait au contraire accélérer fortement la transition : fermer les centrales à charbon les plus émettrices, déployer les renouvelables à une échelle sans précédent et adopter de nouveaux modes de consommation plus sobres en énergie. La période actuelle apparaît critique à cet égard : la crise énergétique de 2022-2023 a rappelé la vulnérabilité et l’insoutenabilité de notre système fondé sur les fossile iea.org iea.org, mais elle a aussi servi de catalyseur pour investir dans des solutions alternatives (sobriété, diversification, renouvelables).
En conclusion, l’histoire de l’énergie depuis 1950 est celle d’une croissance prodigieuse de la consommation, portée par le développement socio-économique mondial et un recours massif aux combustibles fossiles. Cette évolution a permis des avancées sans précédent en termes d’industrialisation et de confort de vie, tout en engendrant des déséquilibres environnementaux majeurs. Le défi du XXIe siècle est désormais de réinventer le système énergétique pour concilier les besoins d’une humanité toujours avide d’énergie avec les limites planétaires. La transition vers un mix énergétique durable, moins carboné et plus équitable régionalement, est en cours mais doit s’intensifier pour relever les enjeux climatiques et assurer une consommation d’énergie viable pour les générations futures.
Sources : _Agence internationale de l’énergie, Our World in Data, BP Statistical Review, Encyclopédie de l’Énergie, Wikipédia (données 2022-2023). ourworldindata.org fr.wikipedia.org fr.wikipedia.org fr.wikipedia.org connaissancedesenergies.org connaissancedesenergies.org connaissancedesenergies.org iea.org iea.org climate.selectra.com
L’évolution de la consommation d’énergie dans le monde
Une demande mondiale en forte croissance depuis 1950
La consommation énergétique mondiale a augmenté de manière spectaculaire depuis le milieu du XXe siècle. Elle a été multipliée par environ huit entre 1950 et aujourd’hui ourworldindata.org. En 1950, le monde consommait de l’ordre de quelques milliers de Mtep d’énergie primaire ; en 2023, la demande annuelle dépasse 620 exajoules (soit environ 14 800 Mtep, ou 172 000 TWh) fr.wikipedia.org. Cette hausse reflète la croissance démographique et économique : la population mondiale s’est fortement accrue et de nombreux pays se sont industrialisés, entraînant une explosion des besoins énergétiques. Par exemple, entre 1990 et 2019, la consommation mondiale est passée de 357 à 589 EJ (+65 %) connaissancedesenergies.org. Chaque décennie jusqu’en 2020 a vu une progression de la demande, hormis un ralentissement ponctuel en 2020 (pandémie de Covid-19) vite compensé par un rebond en 2021 bp.com.
En dépit des améliorations d’efficacité énergétique, la consommation par habitant a continué de croître légèrement, de sorte que la demande mondiale d’énergie augmente un peu plus vite que la population depuis 1990 fr.wikipedia.org. Globalement, l’humanité n’a jamais autant consommé d’énergie qu’aujourd’hui. Cette trajectoire reste portée par le développement économique, l’urbanisation et l’accès accru à l’électricité dans de nombreuses régions du globe. La dépendance aux combustibles fossiles instaurée avec la révolution industrielle a perduré : ces sources d’énergie dominent toujours le bilan énergétique planétaire malgré l’essor récent des alternatives.
Évolution par source d’énergie primaire
Énergies fossiles : charbon, pétrole et gaz naturel
Les combustibles fossiles (charbon, pétrole, gaz) constituent la base du mix énergétique moderne et dominent depuis la révolution industrielle ourworldindata.org iea.org. Dans les années 1950, le charbon était encore la première source d’énergie mondiale, utilisé massivement dans l’industrie et la production d’électricité. Cependant, la seconde moitié du XXe siècle a vu le règne du pétrole : la demande de pétrole a explosé après la Seconde Guerre mondiale, pour en faire la source d’énergie la plus consommée à partir des années 1960-1970. Le gaz naturel, de son côté, a pris son essor plus tard avec le développement des gazoducs et a connu une croissance soutenue à partir des années 1970.
Aujourd’hui, les fossiles fournissent toujours environ 80 % de l’énergie primaire mondiale iea.org. Le pétrole reste la première source individuelle, représentant 30,2 % de l’énergie primaire en 2022 fr.wikipedia.org. Sa part a légèrement diminué par rapport à 1990 (37,2 %) en raison de la diversification du mix fr.wikipedia.org, mais la consommation de pétrole a tout de même fortement augmenté en volume (+~40 % sur les vingt dernières années). En 2022, environ 27,6 % de l’énergie mondiale était fournie par le charbon fr.wikipedia.org. Après un déclin relatif dans les années 1990, l’usage du charbon a rebondi avec l’industrialisation rapide de l’Asie : la consommation de charbon a notamment triplé en Chine entre 1990 et 2023 fr.wikipedia.org. Globalement, la part du charbon est passée de 25,5 % en 1990 à 27,6 % en 2022 fr.wikipedia.org – une hausse modeste en pourcentage, mais sa consommation absolue a connu un pic au milieu des années 2010 (soutenu par la Chine et l’Inde) avant une stabilisation récente. Le gaz naturel, enfin, est la source fossile ayant connu la progression la plus rapide sur la période récente. Sa part est passée d’environ 20 % en 1990 à 23,1 % en 2022 fr.wikipedia.org. En volume, la consommation de gaz a crû d’environ un tiers depuis 2000, reflétant son déploiement comme source d’électricité et de chauffage moins carbonée que le charbon. Cette évolution vers davantage de gaz s’observe particulièrement en Europe et en Asie.
Malgré des variations internes (transition du charbon vers le pétrole puis le gaz), l’ensemble énergies fossiles a conservé une prédominance durable. En 1970, elles représentaient plus de 90 % de l’approvisionnement énergétique mondial, et encore 81,8 % en 2022 connaissancedesenergies.org. Les efforts pour réduire cette dépendance commencent à peine à infléchir la tendance. On constate certes un recul progressif de la part du pétrole et une stabilisation du charbon dans le mix récent, mais le trio pétrole-gaz-charbon n’en continue pas moins d’alimenter l’essentiel de la croissance énergétique mondiale au début du XXIe siècle.
L’énergie nucléaire
Introduite commercialement dans les années 1950, l’énergie nucléaire s’est rapidement développée dans les décennies suivantes. La production mondiale d’électricité d’origine nucléaire est passée de seulement 25 TWh en 1965 à près de 1 945 TWh en 1989, grâce aux nombreux réacteurs construits en Europe, en Amérique du Nord et en Asie connaissancedesenergies.org. La part du nucléaire dans l’énergie primaire mondiale a atteint un pic d’environ 6 à 7 % vers la fin des années 1990 (6,64 % en 2000) connaissancedesenergies.org. Depuis, son poids relatif a décliné à 4 % environ en 2022 connaissancedesenergies.org. Cette baisse s’explique par la croissance plus rapide des autres sources et par un rythme de nouvelles constructions plus lent après les années 1990 (lié notamment aux accidents de Three Mile Island en 1979, Tchernobyl en 1986 et Fukushima en 2011).
En termes de volume, la production nucléaire mondiale a stagné ces deux dernières décennies. Après avoir plafonné au début des années 2000, elle a retrouvé en 2021 son niveau record d’avant Fukushima (environ 2 762 TWh) connaissancedesenergies.org. En 2023, elle atteignait 2 686 TWh connaissancedesenergies.org, soit un niveau quasi équivalent à celui de 2006. Plusieurs pays développés ont ralenti ou arrêté leurs programmes nucléaires (ex. Allemagne, Japon), tandis que d’autres (Chine, Russie, Inde) poursuivent de nouvelles constructions. Le nucléaire contribue aujourd’hui à environ 10 % de la production d’électricité mondiale fr.wikipedia.org, mais seulement ~4 % de l’énergie primaire totale. Son rôle futur dépendra des choix politiques : certains y voient un atout bas-carbone à consolider, d’autres privilégient le développement des renouvelables et l’efficacité énergétique.
Les énergies renouvelables : hydraulique, éolien, solaire, biomasse
Les sources d’énergie renouvelables regroupent l’hydroélectricité, la biomasse (bois, déchets organiques, biocarburants), l’énergie éolienne, solaire, géothermique, etc. En 1950, la principale énergie renouvelable utilisée était la biomasse traditionnelle (bois de chauffe, résidus agricoles), particulièrement dominante dans les zones rurales des pays en développement. Au milieu du XXe siècle, cette biomasse représentait encore une part significative de la consommation énergétique dans de nombreuses régions. Cependant, son importance relative a diminué à mesure que les combustibles fossiles prenaient le relais pour les usages modernes (transport, électricité, industrie). L’autre renouvelable historique est l’hydroélectricité : dès les années 1950-1970, de grands barrages hydroélectriques ont été édifiés (États-Unis, Europe, puis Amérique latine, Asie) fournissant une électricité abondante et bon marché dans certains pays.
Depuis le début du XXIe siècle, on assiste à une expansion accélérée des énergies renouvelables modernes. La part des renouvelables dans le mix énergétique mondial, qui n’était que 6,3 % en 1970, a plus que doublé pour atteindre 14,2 % en 2022 connaissancedesenergies.org connaissancedesenergies.org. Cette croissance est portée par les progrès technologiques, la baisse des coûts et les politiques climatiques incitatives. L’hydraulique reste la première source renouvelable d’électricité : en 2022, elle contribue environ 6,4 % de l’énergie primaire mondiale fr.wikipedia.org et près de 15 % de la production électrique en.wikipedia.org. La production hydroélectrique a crû régulièrement (grands barrages en Chine, Brésil, Afrique…), avec une augmentation d’environ +60 % de 2000 à 2020.
Les énergies éolienne et solaire connaissent, quant à elles, une progression exponentielle. Quasi inexistantes en 2000, elles représentent en 2023 environ 8 % de l’électricité mondiale en.wikipedia.org. L’éolien fournit désormais plus de 2 500 TWh par an, et le solaire plus de 2 100 TWh en.wikipedia.org – des niveaux atteints après des doublesments successifs de capacité chaque décennie. En deux décennies, l’éolien a vu sa production multipliée par plus de 50, et le solaire photovoltaïque par plus de 100. Même si leur part dans l’énergie primaire totale reste modeste (~1-2 % chacun), ces deux filières contribuent de plus en plus au mix électrique et enregistrent les plus fortes croissances de tous les secteurs énergétiques. Enfin, la biomasse moderne (biocarburants, biomasse énergétique industrielle) s’est développée (éthanol, biodiesel, centrales biomasse), mais la consommation traditionnelle de bois stagne ou recule dans certaines régions grâce à l’accès à des combustibles modernes. Au total, la biomasse et les déchets comptent encore pour une part non négligeable du mix (on l’estime à environ 7-8 % de l’énergie primaire en 2022), bien que leur part relative ait baissé depuis 1990 du fait de l’essor des autres renouvelables fr.wikipedia.org.
En somme, les énergies renouvelables ont entamé une percée notable dans le système énergétique mondial. Leurs coûts en baisse et les préoccupations environnementales ont conduit à une multiplication des investissements dans l’éolien et le solaire, qui sont devenus en quelques années des composantes majeures de l’expansion électrique. La transition est toutefois graduelle : en 2022, les renouvelables (y compris hydro et biomasse) fournissent environ 16 % de la consommation finale d’énergie fr.wikipedia.org – un chiffre en hausse lente, car la forte progression des nouvelles EnR compense tout juste le recul de la biomasse traditionnelle fr.wikipedia.org.
Tableau : Comparatif des sources d’énergie (parts, croissance et émissions)
| Source d’énergie | Part du mix (2022) | Croissance (2002–2022) | Émissions CO₂ associées (annuelles) |
|---|---|---|---|
| Charbon | 27,6 % fr.wikipedia.org | + ~15 % | ~15,5 Gt CO₂ (2022) iea.org |
| Pétrole | 30,2 % fr.wikipedia.org | + ~40 % | ~11,4 Gt CO₂ (2022) fr.wikipedia.org |
| Gaz naturel | 23,1 % fr.wikipedia.org | + ~35 % | ~7–8 Gt CO₂ (2022, estimé) |
| Nucléaire | ~4 % connaissancedesenergies.org | ~ stable | ~0 (0,006 kgCO₂/kWh) climate.selectra.com |
| Hydroélectricité | ~6,4 % fr.wikipedia.org | + ~50 % | ~0 (0,006 kgCO₂/kWh) climate.selectra.com |
| Éolien | ~1–2 % (énergie primaire) | + >2000 % | ~0 (très faibles) |
| Solaire | ~1 % (énergie primaire) | + >5000 % | ~0 (très faibles) |
| Biomasse | ~8 % (incl. déchets) | + ~20 % | Combustion neutre en CO₂ * |
* Note : la biomasse émet du CO₂ lors de sa combustion, mais il s’agit de carbone recyclé de l’atmosphère par la croissance des plantes ; son **bilan net** peut donc être neutre si la ressource est gérée durablement (replantation, etc.).
Différences régionales marquantes
L’évolution de la consommation d’énergie n’est pas homogène selon les régions du monde. Au cours des dernières décennies, on observe un déplacement du centre de gravité énergétique vers les pays émergents. En 1970, la majeure partie de l’énergie était consommée par les économies industrialisées d’Amérique du Nord, d’Europe et d’ex-URSS. Depuis, la croissance de la demande provient surtout de l’Asie, du Moyen-Orient et, dans une moindre mesure, de l’Amérique latine et de l’Afrique.
La consommation énergétique des pays en développement a explosé avec l’industrialisation et l’urbanisation. Par exemple, la région Asie-Pacifique est passée de 16 % de la consommation mondiale en 1973 à 45 % en 2019 encyclopedie-energie.org. La Chine à elle seule représente aujourd’hui 22,8 % de … la consommation mondiale en 2022, devant les États-Unis (15,7 %), l’Inde (6,7 %) et la Russie (5,3 % fr.wikipedia.org. À eux quatre, ces pays concentraient plus de la moitié de la consommation énergétique planétaire en 202 fr.wikipedia.org. La croissance récente est surtout tirée par l’Asie : entre 1990 et 2019, la consommation de l’Asie a quasiment triplé, passant de 107 EJ à 299 EJ par a connaissancedesenergies.org, reflétant l’essor industriel de la Chine et de l’Inde. En revanche, dans les économies matures (Europe, Amérique du Nord, Japon), la demande d’énergie a progressé beaucoup plus lentement et tend à se stabiliser voire baisser légèrement depuis les années 2010. Par exemple, la consommation de l’Europe ne représentait que 17 % du total mondial en 2019 (107 EJ connaissancedesenergies.org, en déclin relatif sur longue période.
On note d’importantes disparités de consommation par habitant : un Nord-Américain moyen consomme plusieurs fois plus d’énergie qu’un Africain. Les plus gros consommateurs d’énergie par tête utilisent plus de dix fois l’énergie des plus petits consommateur ourworldindata.org. Cette inégalité reflète le niveau de vie, l’accès aux technologies et l’efficacité énergétique des différentes économies. Globalement, les pays développés ont déjà un usage énergétique élevé et optimisé, tandis que de nombreux pays émergents voient leur consommation par habitant augmenter avec l’amélioration des infrastructures et du pouvoir d’achat.
Les facteurs d’évolution de la consommation
Plusieurs facteurs clés expliquent l’évolution de la demande d’énergie depuis 1950 :
- La croissance démographique et économique : L’augmentation de la population mondiale (passée d’environ 2,5 à 8 milliards d’habitants de 1950 à 2025) et l’essor économique (PIB mondial multiplié par plus de 10 sur la même période) ont mécaniquement accru les besoins en énergie. L’industrialisation rapide de pays comme la Chine, l’Inde ou les « Tigres » d’Asie du Sud-Est a été particulièrement énergivore, tout comme auparavant celle de l’Europe de l’Est ou du Moyen-Orien encyclopedie-energie.org. L’urbanisation et le développement des transports motorisés ont également intensifié la demande.
- Le niveau de vie et la modernisation des usages : L’accès universel à l’électricité, la généralisation de l’électroménager, de la climatisation ou encore de l’informatique ont augmenté la consommation dans les ménages. De même, l’essor de la mobilité (automobile, avion) a fait bondir la demande de carburants. Dans les pays émergents, le passage de modes de vie ruraux (basés sur la biomasse traditionnelle) à des modes de vie urbains connectés au réseau et aux carburants fossiles a provoqué une transition énergétique interne qui accroît temporairement la consommation par habitant.
- Les innovations technologiques et la disponibilité des ressources : Le développement de nouvelles techniques d’extraction et de conversion a ouvert l’accès à plus d’énergie. Par exemple, l’exploitation des gisements offshore et le forage horizontal ont permis d’accroître la production de pétrole et de gaz. Plus récemment, la fracturation hydraulique a révolutionné la production de gaz (et pétrole) de schiste en Amérique du Nord, rendant le gaz abondant et bon marché. De même, les progrès en ingénierie ont abaissé les coûts de l’éolien et du solaire, favorisant leur déploiement. Chaque nouvelle source disponible (nucléaire dans les années 1970, renouvelables dans les années 2000) est venue s’ajouter aux précédentes plutôt que s’y substituer entièrement, alimentant la croissance globale de l’offre d’énergie.
- Les chocs géopolitiques et les politiques publiques : Des événements comme les chocs pétroliers de 1973 et 1979 ont temporairement freiné la consommation en Occident en incitant aux économies d’énergie et en déclenchant des politiques d’efficacité énergétique (limitation de vitesse, isolation des bâtiments, etc.). Inversement, la période de pétrole bon marché des années 1990 a encouragé un usage intensif des carburants. Depuis les années 2000, les préoccupations climatiques et les politiques associées (taxes carbone, subventions aux renouvelables, normes d’efficacité) influencent de plus en plus la trajectoire énergétique. Par exemple, l’Union européenne s’est fixée des objectifs contraignants sur les énergies renouvelables et l’efficacité, infléchissant sa demande énergétique. Globalement, on observe un début de découplage entre croissance économique et consommation d’énergie dans certains pays avancés, grâce aux gains d’efficacité : sur la décennie 2010, la consommation mondiale augmentait en moyenne de +1,5 %/an, moins vite que le PIB mondia iea.org.
- Les choix du mix énergétique et l’accès aux ressources : Certains pays ont misé sur des ressources locales abondantes – par exemple le charbon en Chine ou en Inde pour soutenir leur industrialisation, ou le gaz naturel au Moyen-Orient. D’autres, dépourvus de ressources fossiles, ont développé le nucléaire (France) ou l’hydroélectricité (Brésil, Canada, Norvège). Ces orientations stratégiques ont modulé l’évolution de la consommation par source d’énergie. Par ailleurs, l’accès à l’énergie moderne s’est fortement amélioré dans les pays du Sud : l’ONU estime que 75 millions de personnes pourraient retomber dans la précarité énergétique en 2022 du fait de la crise des prix, mais cela fait suite à des décennies de progrès où plus d’un milliard de personnes ont obtenu l’accès à l’électricit iea.org iea.org.
Enjeux environnementaux et transition énergétique
L’essor massif de la consommation d’énergie s’est accompagné de conséquences environnementales majeures. En premier lieu, la combustion du charbon, du pétrole et du gaz émet des gaz à effet de serre, principalement du dioxyde de carbone (CO₂), responsable du changement climatiqu fr.wikipedia.org. Les émissions mondiales de CO₂ liées à l’énergie ont ainsi grimpé de ~6 milliards de tonnes en 1950 à plus de *36 milliards de tonnes en 2021 weforum.org weforum.org, atteignant un record de *36,8 Gt CO₂ en 2022 iea.org. Cela représente une augmentation de près de 90 % depuis 1970 climate.selectra.com. La consommation de charbon est particulièrement polluante : ce combustible reste le plus émetteur de CO₂ par kWh d’énergie produite (environ 1,06 kg CO₂ par kWh climate.selectra.com. En 2022, les centrales à charbon du monde ont rejeté près de 15,5 Gt de CO₂, soit environ 42 % des émissions énergétique iea.org. Le pétrole a engendré environ 11,4 Gt CO₂ (33 % du total) la même année fr.wikipedia.org, et le gaz naturel autour de 7 à 8 Gt (environ 20 %). Cet usage intensif des combustibles fossiles fait du secteur de l’énergie le principal contributeur au réchauffement climatique actuel climate.selectra.com.
Au-delà du climat, les énergies fossiles posent d’autres problèmes environnementaux. Leur extraction et leur transport entraînent des marées noires, des pollutions des sols et des eaux (extractions de sable bitumineux, fuites de gaz, déforestation pour le charbon, etc.), tandis que leur combustion dégage des polluants atmosphériques nocifs pour la santé (particules fines, oxydes d’azote, soufre…). On estime que la pollution de l’air liée aux combustibles fossiles cause des millions de décès prématurés chaque année dans le monde ourworldindata.org. Les impacts locaux (pluies acides, smog urbain, mercure issu des centrales à charbon) et globaux (dérèglement du climat, acidification des océans) ont conduit à une prise de conscience de l’impératif de changer de modèle énergétique.
Ainsi, depuis une vingtaine d’années, les politiques climatiques et la transition énergétique occupent une place centrale dans les agendas internationaux. L’Accord de Paris de 2015 engage la communauté mondiale à limiter le réchauffement « nettement en dessous de 2 °C », ce qui implique de réduire drastiquement les émissions de CO₂ dans les prochaines décennies. Concrètement, cela nécessite une transformation profonde du système énergétique : amélioration de l’efficacité (faire plus avec moins d’énergie), électrification des usages (transport électrique, pompes à chaleur) et surtout substitution des énergies fossiles par des sources bas-carbone. Les énergies renouvelables (solaire, éolien, hydro, biomasse durable) et le nucléaire font partie des solutions pour décarboner la production d’électricité et de chaleur. Parallèlement, des technologies comme le captage et stockage du carbone (CSC) ou l’hydrogène vert sont explorées pour réduire l’empreinte carbone des secteurs difficiles à électrifier.
Les efforts mondiaux de transition commencent à se refléter dans les investissements : en 2023-2024, les capitaux engagés dans les énergies renouvelables et propres dépassent de plus du double ceux consacrés aux énergies fossile connaissancedesenergies.org. De nombreux pays ont adopté des objectifs de neutralité carbone à l’horizon 2050–2060, et mettent en place des plans pour fermer les centrales au charbon les plus anciennes, déployer massivement éoliennes et panneaux solaires, et promouvoir les véhicules électriques. Ces actions contribuent déjà à infléchir légèrement la trajectoire d’émissions : en 2022, malgré un rebond de l’usage du charbon, la hausse des émissions de CO₂ (+0,9 %) est restée inférieure à la croissance économique, grâce à l’essor des énergies propres qui a évité environ 550 Mt de CO₂ supplémentaire iea.org iea.org.
Néanmoins, les défis restent immenses. La part des combustibles fossiles dans le mix mondial demeure obstinément élevée (autour de 80 % iea.org et les émissions de CO₂ atteignent des niveaux records. Selon les projections de l’Agence internationale de l’énergie, avec les politiques actuelles, les énergies fossiles pourraient encore représenter ~60 % de l’approvisionnement en 2050, et les émissions annuelles ne redescendraient qu’à ~32 Gt à cet horizon iea.org – un scénario insuffisant pour contenir le réchauffement climatique. Pour parvenir aux objectifs climatiques, il faudrait au contraire accélérer fortement la transition : fermer les centrales à charbon les plus émettrices, déployer les renouvelables à une échelle sans précédent et adopter de nouveaux modes de consommation plus sobres en énergie. La période actuelle apparaît critique à cet égard : la crise énergétique de 2022-2023 a rappelé la vulnérabilité et l’insoutenabilité de notre système fondé sur les fossile iea.org iea.org, mais elle a aussi servi de catalyseur pour investir dans des solutions alternatives (sobriété, diversification, renouvelables).
En conclusion, l’histoire de l’énergie depuis 1950 est celle d’une croissance prodigieuse de la consommation, portée par le développement socio-économique mondial et un recours massif aux combustibles fossiles. Cette évolution a permis des avancées sans précédent en termes d’industrialisation et de confort de vie, tout en engendrant des déséquilibres environnementaux majeurs. Le défi du XXIe siècle est désormais de réinventer le système énergétique pour concilier les besoins d’une humanité toujours avide d’énergie avec les limites planétaires. La transition vers un mix énergétique durable, moins carboné et plus équitable régionalement, est en cours mais doit s’intensifier pour relever les enjeux climatiques et assurer une consommation d’énergie viable pour les générations futures.
Sources : _Agence internationale de l’énergie, Our World in Data, BP Statistical Review, Encyclopédie de l’Énergie, Wikipédia (données 2022-2023). ourworldindata.org fr.wikipedia.org fr.wikipedia.org fr.wikipedia.org connaissancedesenergies.org connaissancedesenergies.org connaissancedesenergies.org iea.org iea.org climate.selectra.com
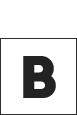


Sorry, the comment form is closed at this time.