23 Fév L’évolution du PIB mondial depuis 1960
Le produit intérieur brut (PIB) mondial a connu une croissance spectaculaire depuis 1960. En termes nominaux, il est passé d’environ 1 000 milliards de dollars US en 1960 à plus de 100 000 milliards en 2020 en.wikipedia.org en.wikipedia.org. Ce bond énorme reflète à la fois la croissance réelle de l’activité économique et l’inflation. En volume (dollars constants), la production mondiale s’est accrue d’un facteur d’environ huit sur cette période, témoignant d’un essor économique sans précédent en.wikipedia.org weforum.org. L’augmentation du PIB mondial a été portée par la croissance démographique (la population mondiale a plus que doublé depuis 1960) et l’élévation du PIB par habitant, notamment grâce au développement rapide de nombreuses économies émergentes.
Les grandes tendances par décennie
Années 1960 : « Trente Glorieuses » mondiales
Les années 1960 ont été une décennie de forte expansion économique à l’échelle mondiale. C’est durant cette période que la croissance du PIB planétaire a atteint son rythme le plus élevé, profitant de l’essor d’après-guerre dans les pays développés et du début d’industrialisation de plusieurs pays en développement en.wikipedia.org. Les puissances occidentales (États-Unis, Europe de l’Ouest, Japon) connaissent alors les Trente Glorieuses, avec des taux de croissance annuels souvent supérieurs à 5 %. La généralisation du commerce international dans le cadre de Bretton Woods, les gains de productivité industriels et une main-d’œuvre abondante soutiennent la hausse de la production. En fin de décennie (vers 1970), le PIB mondial en volume est déjà presque double de son niveau de 1960.
Années 1970 : chocs pétroliers et stagflation
Au début des années 1970, la croissance mondiale ralentit. La décennie est marquée par deux chocs pétroliers (1973 et 1979) qui provoquent des flambées du prix du baril de pétrole et une forte inflation dans les économies avancées en.wikipedia.org. Ces chocs entraînent une stagflation – combinaison de stagnation économique et de forte inflation – notamment aux États-Unis et en Europe de l’Ouest. Après le premier choc pétrolier, la croissance mondiale tombe brutalement : dans la zone OCDE, elle passe d’environ +6,3 % en 1973 à –0,4 % en 1975 statista.com. L’année 1975 voit ainsi la première récession mondiale de l’après-guerre (le PIB agrégé recule légèrement). La fin de la décennie reste difficile, avec un second choc pétrolier en 1979 qui ravive les pressions inflationnistes et mène à de nouvelles contractions d’activité en 1980-1982. Globalement, la croissance annuelle moyenne du PIB mondial dans les années 1970 (environ 3–4 %) est nettement inférieure à celle des années 1960 (autour de 5 %), traduisant ce net ralentissement.
Années 1980 : ralentissement et ajustements
Les années 1980 prolongent les tendances apparues dans la seconde moitié des années 1970. Face à l’inflation élevée, les grandes banques centrales (notamment la Réserve fédérale américaine sous Paul Volcker) mènent des politiques monétaires restrictives au tout début de la décennie, ce qui contribue à une récession mondiale en 1981-1982. Parallèlement, de nombreuses économies en développement font face à la crise de la dette : l’envolée des taux d’intérêt et la baisse des prix des matières premières plongent des pays d’Amérique latine et d’Afrique subsaharienne dans de graves difficultés financières, entraînant ce que l’on a appelé la « décennie perdue » pour le développement de certaines régions. Ainsi, la croissance mondiale demeure modeste dans les années 1980 (autour de 3 % par an en moyenne) malgré le dynamisme persistant de quelques économies d’Asie de l’Est. En fin de décennie, des signes d’amélioration apparaissent : l’inflation est maîtrisée dans les pays avancés, préparant le terrain pour un rebond dans la décennie suivante.
Années 1990 : transition et mondialisation
La chute du bloc soviétique autour de 1990 engendre une transition économique difficile dans de nombreux pays d’Europe de l’Est et en ex-URSS, se traduisant par un recul de leur PIB au début des années 1990. Malgré ce frein régional, les années 1990 voient une reprise de la croissance mondiale à un rythme modéré. La mondialisation s’accélère sous l’effet de l’ouverture commerciale (cycles du GATT puis création de l’OMC en 1995) et des progrès technologiques (essor de l’informatique et d’Internet). L’Asie émerge comme moteur : les Tigres d’Asie de l’Est (Corée du Sud, Taïwan, Hong Kong, Singapour) continuent leur essor, et surtout la Chine – engagée dans des réformes de marché – enregistre des taux de croissance à deux chiffres. L’Inde entame également de fortes croissances à partir des réformes de 1991. Vers la fin de la décennie, la crise financière asiatique de 1997 perturbe temporairement cette région (avec une contraction de l’activité dans les pays touchés), mais l’impact global reste limité et de courte durée. Au total, la croissance mondiale dans les années 1990 se maintient autour de 3 % l’an. La fin de la décennie est marquée par la bulle technologique (dot-com), dont l’éclatement en 2000 aura surtout des effets au début des années 2000.
Années 2000 : essor des émergents et crise financière
Entre 2000 et 2007, le PIB mondial connaît une forte expansion alimentée par la conjonction de la croissance soutenue des pays développés et d’une accélération sans précédent dans les pays émergents. L’entrée de la Chine à l’OMC (2001) amplifie les flux d’échanges internationaux. La Chine affiche pendant cette période des taux de croissance proches de 10 % par an, rejoignant le rang de deuxième économie mondiale. L’Inde, le Brésil, la Russie (les autres BRIC) connaissent également une croissance rapide grâce à l’urbanisation, l’industrialisation et, pour certains, à la hausse des cours des matières premières. En conséquence, le PIB mondial augmente en moyenne de près de 4 % par an dans les années 2000, un rythme supérieur aux décennies précédentes. En 2008 toutefois, la crise financière mondiale éclate à la suite de la crise des subprimes aux États-Unis. Cette crise bancaire et financière se propage à l’économie réelle : en 2009, le PIB mondial recule légèrement (−0,1 %) – un événement rare – avant de rebondir l’année suivante en.wikipedia.org. Ce Grand Recul de 2009 constitue la première contraction de l’économie mondiale depuis les années 1980 et révèle la forte interdépendance des économies. Grâce à l’action coordonnée des banques centrales et des plans de relance gouvernementaux, la récession est limitée dans le temps : dès 2010, la croissance mondiale repart aux alentours de 5 %. Sur l’ensemble des années 2000, la montée en puissance des pays émergents est le fait marquant, atténué en toute fin de période par la plus grave crise financière depuis 1929.
Années 2010 : reprise inégale et choc pandémique
Dans les années 2010, la croissance globale est relativement modérée. Les économies avancées sortent lentement de la crise financière : la zone euro en particulier traverse une période difficile (crise des dettes souveraines de 2010-2012, avec récessions dans plusieurs pays européens). Les pays émergents continuent de croître plus vite que la moyenne, mais à un rythme un peu ralenti par rapport aux années 2000 – la Chine, par exemple, voit sa croissance ralentir progressivement de ~10 % à ~6 % par an à la fin de la décennie. Globalement, le PIB mondial progresse d’environ 3–3,5 % par an sur 2010-2019, marquant un palier inférieur à celui d’avant 2008. C’est alors que survient la pandémie de COVID-19 en 2020, qui provoque un choc sans précédent. De vastes confinements et perturbations frappent la plupart des pays à partir de mars 2020, entraînant un effondrement de l’activité au second trimestre 2020. Sur l’ensemble de l’année 2020, l’économie mondiale se contracte de 3,1 % – de loin la plus forte baisse depuis la Seconde Guerre mondiale en.wikipedia.org. Cette Grande Récession mondiale de 2020 est qualifiée par le FMI de pire crise économique depuis la Grande Dépression des années 1930, bien plus sévère que la crise de 2008-2009 imf.org. Fort heureusement, grâce aux mesures de soutien exceptionnelles (politiques budgétaires et monétaires massives) et à la réouverture progressive, le PIB mondial rebondit vivement en 2021 (+5 à +6 %). Néanmoins, la pandémie a fait reculer durablement certains pans de l’économie et creusé des divergences entre pays – la reprise étant plus rapide en Chine ou aux États-Unis qu’en Europe ou dans de nombreux pays en développement.
Comparaison entre régions : OCDE, BRICS et pays à faible revenu
L’évolution du PIB mondial depuis 1960 s’accompagne d’importants changements dans la géographie économique mondiale. Alors que les pays occidentaux dominaient largement l’économie mondiale au milieu du XX<sup>e</sup> siècle, le centre de gravité économique s’est progressivement déplacé vers l’Asie et les pays émergents au cours des dernières décennies. Voici une comparaison entre quelques grands groupes de pays :
- Pays de l’OCDE (économies développées) : Les nations aujourd’hui membres de l’OCDE (essentiellement l’Amérique du Nord, l’Europe, le Japon, la Corée du Sud, l’Australie…) constituaient historiquement la majeure partie du PIB mondial. Leur part a toutefois diminué au fil du temps, à mesure que le reste du monde croissait plus vite. En 2017, les pays de l’OCDE représentaient environ 42,8 % du PIB mondial en parité de pouvoir d’achat en.wikipedia.org. En 2021, l’ensemble des pays à haut revenu (une catégorie proche de l’OCDE) ne contribue plus qu’à 46 % du PIB mondial (PPA) blogs.worldbank.org. On est loin des estimations des années 1960, où les économies développées pouvaient peser autour de 80 % de la production mondiale (à une époque où la Chine et l’Inde étaient encore très en retard en niveau de vie). Cela reflète une croissance plus lente et arrivée à maturité des pays riches ces dernières décennies, comparée à l’essor rapide des pays émergents.
- BRICS (principaux pays émergents) : Le bloc des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) illustre la montée en puissance des grands pays en développement. En 1990, leur poids cumulé dans l’économie mondiale était encore marginal (quelques pourcents en PIB nominal, autour de 10-15 % en PIB PPA). Au fil des années 2000 et 2010, leur croissance rapide a fait bondir leur contribution. En 2011, les BRIC représentaient déjà 27 % du PIB mondial en PPA dievolkswirtschaft.ch. Cette tendance s’est poursuivie : en 2023, la part des BRICS dans le PIB mondial atteint environ 31,5 %, dépassant pour la première fois celle du G7 (30,7 %) fr.wikipedia.org. Il s’agit d’un renversement historique du rapport de force économique. La Chine en particulier, avec près de 19 % du PIB mondial à elle seule en 2021 (en PPA), est devenue la première économie mondiale en parité de pouvoir d’achat blogs.worldbank.org. L’Inde est également dans le top 3 mondial (7 % du PIB mondial PPA en 2021) blogs.worldbank.org. Les BRICS tirent donc une large part de la croissance globale et leur poids devrait encore s’accentuer dans le futur d’après les projections fr.wikipedia.org.
- Pays à faible revenu : À l’autre extrémité, les pays classés par la Banque mondiale comme faible revenu (essentiellement en Afrique subsaharienne et quelques autres États) contribuent très faiblement au PIB mondial. Leur part est restée à peu près stable et minime depuis 1960. En 2021, l’ensemble des pays à faible revenu (qui regroupent environ 8 % de la population mondiale) ne représente qu’un peu plus de 1 % du PIB mondial en PPA blogs.worldbank.org. Cela souligne le très faible niveau de richesse et de production de ces pays, malgré des croissances parfois rapides localement. La divergence de revenu par habitant avec le reste du monde reste un enjeu majeur, et ces pays contribuent peu à la croissance économique globale du fait de la petitesse de leurs économies.
Grandes ruptures et crises historiques
Plusieurs ruptures ont jalonné l’évolution du PIB mondial depuis 1960, correspondant à des crises économiques globales ou des chocs affectant de larges régions du monde. On peut citer en particulier :
- Les chocs pétroliers des années 1970 : en 1973 puis 1979, les flambées des prix du pétrole décidées par l’OPEP provoquent inflation et récessions dans de nombreux pays industrialisés, entraînant le ralentissement de la croissance mondiale évoqué plus haut en.wikipedia.org. Ces événements marquent la fin de la période de forte croissance des Trente Glorieuses.
- La crise de la dette des années 1980 : initiée par le Mexique en 1982, la crise de la dette souveraine frappe plusieurs pays en développement incapables de faire face au service de leur dette extérieure suite à la hausse des taux américains. Elle entraîne des programmes d’ajustement structurel et une décennie de quasi-stagnation dans les pays touchés (Amérique latine, Afrique).
- La crise financière asiatique de 1997 : partie de Thaïlande, elle se propage à toute l’Asie de l’Est et fait chuter fortement le PIB de pays comme l’Indonésie ou la Corée en 1998. Le choc demeure toutefois régional et la croissance mondiale n’est que légèrement réduite.
- La grande crise financière de 2008 : l’effondrement du marché immobilier américain et des titres financiers adossés aux crédits subprime conduit à la faillite de Lehman Brothers en septembre 2008. S’ensuit une panique financière mondiale et une forte récession dans les pays avancés fin 2008-début 2009. Le PIB mondial recule en 2009 pour la première fois depuis des décennies en.wikipedia.org. Cette crise a mené à un renforcement de la réglementation bancaire internationale et à des politiques monétaires non conventionnelles.
- La pandémie de COVID-19 (2020) : il s’agit du choc le plus brutal qu’ait connu l’économie mondiale en temps de paix. En l’espace de quelques semaines, l’activité mondiale s’est contractée violemment, aboutissant à une chute de plus de 3 % du PIB en 2020 en.wikipedia.org. Aucun continent n’a été éparé. La riposte des États (soutiens budgétaires massifs) a permis une reprise rapide en 2021, mais la pandémie laisse des séquelles économiques (endettement public accru, désorganisation de chaînes d’approvisionnement) et a temporairement inversé la tendance de croissance du PIB mondial.
Tendances futures et projections
Quelles sont les perspectives pour le PIB mondial dans les années à venir ? Les organisations internationales anticipent une croissance modérée à moyen terme. Le Fonds monétaire international estime que la croissance mondiale devrait se stabiliser autour de 3 % par an durant les cinq prochaines années, soit la plus faible perspective à moyen terme depuis 1990 lefigaro.fr. En d’autres termes, après le rebond post-COVID, l’économie mondiale renouerait avec un rythme d’expansion relativement plus lent que celui d’avant 2008, en partie en raison du ralentissement attendu dans les pays riches (vieillissement démographique, productivité en berne) et du tassement de la croissance chinoise.
Dans le même temps, la contribution des différentes régions va continuer d’évoluer. La tendance de fond est à une montée en puissance continue des économies émergentes d’Asie et d’ailleurs, alors que le poids relatif des économies avancées stagnera ou diminuera. D’après les projections, la part des BRICS et de leurs partenaires devrait encore augmenter dans la décennie à venir, renforçant le basculement du PIB mondial vers l’Asie fr.wikipedia.org. Les pays à faible revenu, en revanche, devraient rester marginalisés en termes de PIB tant que leur croissance par habitant ne décolle pas véritablement.
Enfin, de nouveaux défis pourraient influencer la trajectoire du PIB mondial : la transition écologique pour lutter contre le changement climatique, par exemple, nécessitera des investissements massifs mais pourrait à terme affecter positivement la croissance via de nouvelles technologies “vertes”. De même, la transformation numérique en cours (intelligence artificielle, automatisation) est susceptible de doper la productivité globale sur le long terme. En somme, si le rythme d’augmentation du PIB mondial devrait être plus mesuré qu’au cours de la deuxième moitié du XX<sup>e</sup> siècle, l’économie mondiale de 2030-2040 sera probablement encore plus importante qu’aujourd’hui, avec un poids toujours plus grand des ex-pays en développement dans la création de richesse mondiale. Les tendances des soixante dernières années – mondialisation des échanges, diffusion du développement économique – semblent donc amenées à se prolonger, tout en devant s’adapter aux enjeux du XXI<sup>e</sup> siècle.
Sources : Données historiques principalement issues de la Banque mondiale (World Development Indicators), du FMI (World Economic Outlook) et de l’OCDE. Les estimations en dollars constants sont généralement exprimées en dollars US de 2015 (ou 2017/2021 pour les données en PPA). Les analyses des tendances et projections s’appuient sur des rapports récents du FMI et de la Banque mondiale lefigaro.fr blogs.worldbank.org, ainsi que sur des publications synthétiques (WEF, Statista) pour l’illustration des évolutions régionales weforum.org.
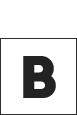


Sorry, the comment form is closed at this time.